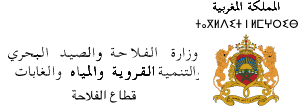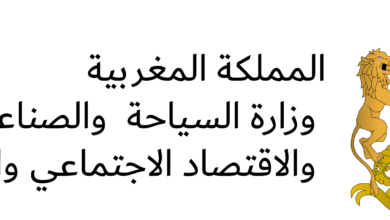MBA | « Le MBA, c'est comme un club » – La Presse
Consulter lapresse.ca
Liens utiles
PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE
Amine Rhali, diplômé au MBA de l’Université de Sherbrooke
En s’inscrivant au MBA de l’Université de Sherbrooke, Amine Rhali prévoyait accumuler les connaissances pour devenir un meilleur gestionnaire. Quand il a commencé son programme, l’ingénieur originaire du Maroc a pris conscience de l’énorme réseau de contacts qu’il développait.
Diplômé depuis le printemps 2022, il dit avoir appris autant de ses professeurs que de ses pairs. « On apprend à les connaître, à avoir des divergences avec eux et à résoudre des problèmes, explique-t-il. On passe du temps ensemble et on s’entraide. »
Peu à peu, son réseau lui a permis de s’intégrer professionnellement.
J’ai des contacts un peu partout avec mes collègues de classe et les anciens du MBA. Ça donne une légitimité avec mes interlocuteurs. C’est comme un club.
Amine Rhali
Son expérience universitaire lui a également fait constater que le Québec lui plaisait énormément. « J’ai été chaleureusement accueilli par une communauté bienveillante. J’ai découvert une société ouverte, tolérante, engagée envers l’égalité des chances et le développement durable. Tout ça rejoignait mes valeurs profondes, alors j’ai décidé de rester avec ma femme et mon fils. »
Les choses allaient pourtant bien au Maroc. Très jeune, il s’était dirigé vers des études en génie industriel à l’École nationale supérieure des arts et métiers. « Ce n’était pas un rêve, mais une des meilleures options, et ça m’intéressait. Depuis mon enfance, j’étais assez doué en sciences et en mathématiques, alors c’était un choix naturel. »
Il a ensuite étudié en France, avant de travailler durant des années dans l’industrie du pétrole et du gaz. « J’ai dû rapidement me lancer en gestion sans être suffisamment outillé », se souvient-il.
PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE
Amine Rhali, diplômé au MBA de l’Université de Sherbrooke
Ma formation en génie était excellente, mais elle était focalisée sur les compétences techniques. Les autres aspects plus humains et relationnels étaient en marge de la formation.
Amine Rhali
Après une décennie sur le terrain, quelque chose clochait. « J’avais de bons résultats et j’évoluais bien dans ma carrière, mais j’avais le sentiment de l’imposteur. Le prochain poste qu’on allait me proposer était un poste de direction, mais quelque chose me manquait. Je ne me fiais qu’à ma logique. Je n’avais pas étudié ça. »
Conscient de ses lacunes en finances et en ressources humaines, il a cru que le MBA allait le mettre à niveau. Son plan initial était d’étudier en Ontario, mais une rencontre avec le directeur du programme à l’Université de Sherbrooke et des échanges avec d’anciens étudiants l’ont convaincu de se poser au Québec. « En discutant avec les anciens, j’ai senti que les valeurs de l’université, le contenu de la formation et le fil conducteur du MBA, centré sur le développement durable, me rejoignaient. »
Au terme de ses études, il a réalisé un stage chez Hydro-Québec, avant d’y obtenir un poste de conseiller en approvisionnement stratégique. Depuis 18 mois, il met en pratique ses apprentissages. « Le MBA ne fait pas de nous des spécialistes, mais des généralistes. On développe des outils qui nous donnent une compréhension de l’ensemble. Quelle que soit la situation, on saura se débrouiller avec ce qu’on a appris. »
Dans l’avenir, Amine Rhali se voit évoluer dans des postes de direction des opérations dans le domaine de l’énergie, en lien avec son expérience passée en génie.
Benjamin Prince, 33 ans, a quitté la France l’an dernier avec sa conjointe pour s’installer au Québec et réaliser un MBA intensif à HEC Montréal. Alors qu’il a travaillé auparavant en finance, en gestion de projet et en politique, il a appris dans le MBA à faire équipe avec des gens actifs dans des secteurs d’activité complètement différents, en plus d’être d’origines et de cultures variées.
Qu’est-ce qui pousse des investisseurs des quatre coins du monde à financer Eli Health ? Il y a un énorme besoin et actuellement aucune offre. Le test développé par la PME permet aux femmes de mesurer elles-mêmes le taux de certaines hormones par la salive et d’obtenir instantanément un portrait en temps réel de leur état de santé global, ce qui est une première. Mesurer le cortisol, par exemple, peut communiquer des informations cruciales en lien avec la fertilité, la ménopause ou la périménopause.
Ora Médical brille dans son milieu. En effet, l’entreprise fondée en 2020 a été couronnée l’an dernier jeune pousse montante de l’année, une reconnaissance décernée par MTL NewTech, et a reçu le prix Women in Tech en juillet dernier au Startupfest de Montréal.
La pandémie a mis en lumière l’importance des sciences de la vie et des technologies de la santé (SVTS), qui peuvent également compter sur l’expertise en intelligence artificielle et sur un bassin de talents dans la région de Montréal. Le secteur a aujourd’hui le vent dans les voiles, se réjouissent les intervenants du secteur.
Quatrième ville en importance au Québec, Gatineau profite naturellement de sa proximité avec Ottawa, capitale nationale du Canada, pour la tenue d’évènements d’entreprises. Mais ce n’est pas une raison pour rester les bras croisés. Dans cette optique, Tourisme Outaouais vient de terminer la mise en ligne de vidéos promotionnelles qui font un tabac.
Nouvelle salle, écran géant et nouveaux lieux pour les activités de consolidation. Ottawa déborde de nouveautés pour les entreprises à la recherche d’endroits pour la tenue de réunions et de congrès ou tout simplement pour l’organisation d’évènements pouvant rallier leurs troupes. Tour d’horizon.
Un sondage réalisé par Léger pour le compte de Tourisme d’Affaires Québec, auprès d’une cinquantaine de membres, révèle que le manque de personnel se classe en cinquième position des préoccupations des organisateurs d’évènements. Loin d’être une nouvelle situation, l’industrie contre-attaque avec des solutions.
Décembre 2022, l’hôtel Mont Gabriel entame sa plus importante fin de semaine après deux ans de pandémie. À 10 h du matin, un incendie se déclare et ravage deux salles, sans parler de la fumée qui envahit tous les espaces. La tragédie est pourtant devenue une bénédiction. L’établissement profite en ce moment d’une cure de jouvence et devrait de nouveau accueillir les clients en juin 2024. Coût de l’investissement : 25 millions.
Au même titre que plusieurs autres régions de la province, le secteur du tourisme d’affaires dans les Laurentides connaît une bonne année, malgré plusieurs défis de taille. La région a par ailleurs un atout dans sa manche ; nombre d’entreprises l’offrent désormais à titre de cadeau de reconnaissance à leurs employés.
Même si elle vit dans l’ombre de la Capitale-Nationale en matière de tourisme, la région de Chaudière-Appalaches jouit d’une grande notoriété. Elle a donc choisi de miser sur cet atout. Et ça fonctionne, car elle se classe au premier rang des régions du Québec concernant le taux de satisfaction moyen des clients pour les hôtels.
Pour proposer de nouveaux espaces ou activités hors des sentiers battus aux groupes d’affaires, Québec ne donne pas sa place cette année. En voici quatre à découvrir qui exploitent différentes richesses de la région, des beautés du fleuve Saint-Laurent au patrimoine culturel des Premières Nations.
Après avoir grandement souffert de la pandémie, le milieu du tourisme d’affaires a repris ses activités à pleine vitesse. Or, alors que tout le Québec est frappé de plein fouet par la pénurie de main-d’œuvre, bien des travailleurs ont quitté le secteur pendant la pause.
La clientèle d’affaires est bien différente de celle d’agrément et pour l’accueillir, il faut investir afin de pouvoir satisfaire ses besoins particuliers. C’est ce que l’on a fait récemment dans de nombreux établissements de l’Estrie. En voici quatre à découvrir pour organiser des évènements d’affaires tout en permettant aux personnes participantes de profiter des beautés de la nature.
Les hôteliers et organisateurs d’évènements de la Montérégie prévoient une hausse du secteur du tourisme d’affaires dans les années à venir. Pas étonnant que certains se lancent dans les projets de rénovation et de développement d’activités.
Les clients d’affaires ne manquent pas à l’appel pour remplir les salles de la Montérégie, mais leurs habitudes ont changé. C’est sans parler des impacts de l’inflation et de la pénurie de main-d’œuvre. En somme, rien n’est plus pareil dans le milieu.
Les hôteliers et leurs partenaires en tourisme d’affaires du Centre-du-Québec sont unanimes, le secteur de la clientèle d’affaires n’est plus le même depuis la pandémie. Les défis auxquels ils doivent faire face sont multiples, mais ils trouvent des solutions et n’hésitent pas à investir.
Nos applications
Contact
Services
Archives
Suivez La Presse
Légal
© La Presse Inc. Tous droits réservés.
Conditions d’utilisation| Politique de confidentialité| Registre de publicité électorale| Code de conduite