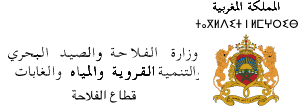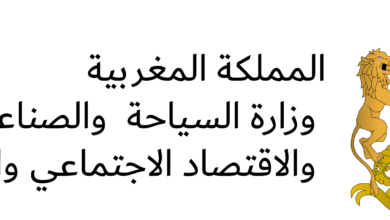Une association de Verviers lance un appel aux dons pour offrir l … – Sudinfo.be
Bienvenue sur votre site d’actualité
Bienvenue sur votre site d’actualité
Une équipe de l’ASBL Essalem a rencontré en juin 2023 les habitants du douar de Noqla dans la région de Rhafsaï au Maroc afin de lancer son nouveau projet de construction d’un puits pour les habitants dans le besoin d’accès à l’eau. Les dons sont ouverts pour soutenir cette initiative.
« Le projet consiste à construire un puits et un château d’eau pour près de 400 foyers, soit environ 2.000 personnes. L’an passé, les autorités locales ont dû acheminer de l’eau via des camions-citernes durant les fortes chaleurs », explique l’association de Verviers dans un communiqué. Comme la rencontre avec les habitants s’est montrée très constructive, l’ASBL Essalem souhaite lancer les études de sol durant les périodes estivales afin de déterminer le meilleur lieu pour procéder au forage.
« Le projet de puits à Labrokat de l’an passé a été très motivant pour les jeunes et nous avons de suite voulu lancer un nouveau projet cette année. Avec le soutien de certaines mamans qui connaissent des villages au Maroc dans le besoin, nous voulons aider des populations en souffrance en donnant l’accès à l’eau, ce qui change littéralement les conditions de vie des habitants du village. L’eau est un bien précieux et cela conscientise aussi les jeunes qui participent à ce projet à ne pas la gaspiller ici aussi » témoigne Mouad Benameur, coordinateur du projet chez Essalem.
L’ASBL estime à 20.000€ le projet de puits de cette année. « La Ville de Verviers et l’Echevin de la Coopération au Développement, M. Antoine Lukoki ont témoigné leur soutien, en versant 2500€», indique l’association. Tout citoyen et toute association sensible à l’accès à l’eau pour tous peut faire un don sur le compte projet BE62 7555 8301 9361 (communication : « don projet puits »).
Vous souhaitez interagir sur cet article ?
Connectez-vous et publiez votre commentaire.
Pas encore de compte ? Je crée mon compte
Souhaitez-vous recevoir davantage d’informations ou bénéficier d’une assistance technique ? Consultez nos explications ici
© Groupe Sudmedia – filiale de Rossel & Cie – 2023
Conditions générales d’utilisation – Conditions générales de vente – Politique de cookies – Politique de Protection Vie privée – Charte des médias – Droits de reproduction –