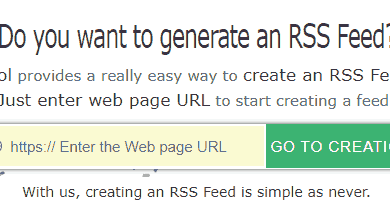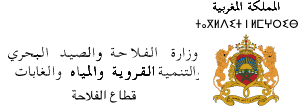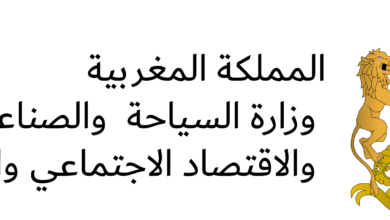L'ancienne chapelle de l'Université d'Ottawa: une œuvre remarquable – Le Droit
La chapelle de l’Université d’Ottawa vers 1889 (AUO-PHO-NB-38-109-1-3/Archives de l'Université d'Ottawa)
En 1886, l’édifice de l’Université d’Ottawa, agrandi à plusieurs reprises depuis 1856, est presque terminé. Il ne manque plus qu’une chapelle permanente. Afin de dessiner les plans de la nouvelle chapelle, le supérieur de l’établissement, le père Joseph-Henri Tabaret, fait appel à un ancien du Collège, le prêtre-architecte Georges Bouillon.
Georges Bouillon s’avère bien connu dans la région pour avoir dessiné l’ornementation intérieure de la cathédrale Notre-Dame et de l’église Saint-Jean-Baptiste d’Ottawa, ainsi que les plans du couvent des Dominicains et du cimetière Notre-Dame d’Ottawa. De plus, il réalise les dessins du presbytère et de l’église Saint-François-de-Sales à Pointe-Gatineau, l’intérieur de l’église Notre-Dame-de-Grâce de Hull, de même que les églises Saint-Paul d’Aylmer et Saint-Grégoire de Nazianze de Buckingham.
On doit également au chanoine la chapelle du Couvent de la rue Rideau démolie en 1972. Heureusement, le décor intérieur, reconnu pour sa richesse néo-Tudor, est restauré et reconstitué, au coût de 1,5 million de dollars, à l’intérieur du Musée des beaux-arts du Canada.
Georges Bouillon est né à Saint-Germain de Rimouski, au Québec, le 11 février 1841. En 1867, il entre à l’Université d’Ottawa. Au cours de ses études classiques, il enseigne le dessin aux élèves de l’établissement. Le père Tabaret remarque ses talents et lui demande de préparer les plans du décor intérieur de l’église Notre-Dame-de-Grâce de Hull, incendiée en 1888.
Le chanoine Georges Bouillon (Bibliothèque et Archives Canada/Courtoisie)
En 1872, Bouillon quitte l’Université d’Ottawa pour terminer ses études théologiques au Grand séminaire de Montréal, où il est ordonné prêtre en 1874. Il retourne immédiatement dans la capitale fédérale pour remplir diverses fonctions à la cathédrale Notre-Dame, dont celle de secrétaire de Mgr Joseph-Thomas Duhamel, deuxième évêque catholique d’Ottawa.
Entre 1883 et 1891, le prêtre-architecte effectue de longs voyages en Europe, en Turquie, en Palestine, au Maroc et en Algérie. Comme le note Norman Pagé, qui a étudié ses réalisations, «ces voyages laissèrent clairement transparaître leur influence, par la suite, dans les choix de styles qui ont caractérisé les plans qu’il élabora pour diverses chapelles et églises.»
Bouillon, qui avait été nommé chanoine en 1889 et prélat domestique par le pape Pie XI en 1924, meurt à Ottawa le 7 avril 1932. Il repose au cimetière Notre-Dame d’Ottawa.
La chapelle de l’Université d’Ottawa, qui peut accueillir un millier de personnes, est bénie solennellement, le 22 juin 1887, par l’archevêque d’Ottawa, Mgr Joseph-Thomas Duhamel. Plusieurs prélats de l’Église catholique y assistent.
La chapelle, de style mozarade selon Bouillon, ou de style mauresque selon d’autres, se rapproche de l’architecture palatiale de l’Inde islamique des 17e et 18e siècles. Le lieu de culte possède un magnifique maître-autel en marbre et en bronze assorti de pierres précieuses, deux autels secondaires et sept autres petits autels nécessaires à la célébration privée de la messe par les oblats qui dirigent la maison d’enseignement. D’immenses chandeliers provenant de Paris éclairent l’endroit.
En somme, cette chapelle, unique au Canada, frappe par sa grandeur ainsi que par la richesse de ses dorures et décorations réalisées en grande partie par Paquette et Godbout, de Saint-Hyacinthe, au Québec. En fait, la surabondance des motifs décoratifs de la voûte et des murs évoque les somptueuses décorations des palais orientaux.
Les coûts de construction, qui s’élèvent à 30 000 dollars, sont défrayés par une campagne de financement organisée pendant trois ans à travers le Canada et les États-Unis.
Nous terminons la présentation de ce chef-d’œuvre architectural par une note de Norman Pagé : «Ce projet est bel et bien le plus original et le plus insolite de tous les plans du chanoine Bouillon. L’artiste n’a pas copié le palais de l’Alhambra, ni la mosquée de Cordoue… mais, encore une fois, il a puisé dans un répertoire stylistique donné, à bon escient, pour produire un plan personnel dans le style mozarabe profondément marqué comme il l’était par l’esprit des formes des grandes œuvres architecturales d’influence islamique de leurs dérivés à travers l’histoire, en Algérie et en Espagne plus particulièrement.»
Cette chapelle, qui faisait la fierté de l’Université d’Ottawa et des oblats, est complètement détruite par un incendie le 2 décembre 1903. Le feu ravage la totalité de l’édifice principal de l’institution et trois personnes y perdent la vie. Nous y reviendrons.
•••
Sources: Luc Noppen, Une des plus belles chapelles du pays, Ottawa, Musée des beaux-arts du Canada, 1998, 108 p. Norman Pagé, « La chapelle du Musée des beaux-arts du Canada et son contexte d’origine », Culture du Canada français, automne 1989, p. 32. Michel Prévost, « Un riche patrimoine disparu : L’ancienne chapelle de l’Université d’Ottawa », Gazette de l’Université d’Ottawa, vol XXII, 2, 16 février 1988, p. 8.
•••
Michel Prévost est une riche ressource pour toute personne s’intéressant à l’histoire régionale (Gatineau, Ottawa, Est Ontarien, Outaouais) et à l’histoire des Franco-Ontariens. Il s’intéresse depuis plus de 40 ans au patrimoine archivistique, historique et bâti de l’Université d’Ottawa.