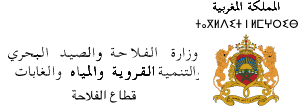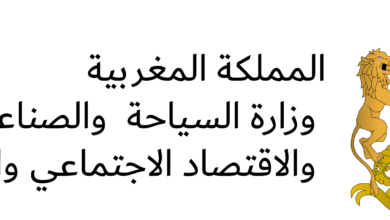Zahra Ahannach, une artiste au cœur des montagnes rifaines – Hespress Français
Près de deux heures sont nécessaires pour parcourir la centaine de kilomètres séparant Al Hoceima de Jebha, la ville portuaire rifaine de la province de Chefchaouen. Une fois arrivés dans la belle petite ville côtière sereine malgré l’afflux de touristes qui commencent à découvrir ses charmes, il faudra encore s’armer de patience avant d’atteindre la destination, objet de notre visite.
Retour à la route où nous devons quitter le bord de mer pour entrer dans les terres rifaines et nous diriger vers le repère suivant, Bni Smih situé à une dizaine de kilomètres et perché à 890 mètres d’altitude. Après avoir quitté le centre de la commune rurale, le cap est mis sur la prochaine étape, Bni Rzine, dans une traversée de 28 kilomètres de lacets qui durera 40 minutes ! La voiture cahote et la pression de l’altitude se fait sentir car Bni Rzine culmine à 1450 mètres d’altitude dans des paysages à couper le souffle malgré les tristes images des figuiers de Barbarie dont les raquettes blanchies courbent l’échine sous le rongement de la cochenille qui s’est propagée à l’espèce dans tout le nord du Maroc.
Les cimes des montagnes taquinent les rares nuages qui osent se pousser du col sous les rayons ardents du soleil aoûtien ; ce dernier inonde la végétation faite d’amandiers, de figuiers, de lentisque mais aussi de grandes parcelles de kif déployées sans complexe et sans égard pour les 56 articles de la loi 13-21 qui soumet pourtant la culture et la production de cannabis à de strictes conditions.
On vient à notre rencontre pour nous guider dans les quelques mètres de piste qui vont enfin, nous mener à notre destination. Bienvenue dans le refuge de Zahra Ahannach : le salon de la maison familiale où elle a élu domicile d’artiste en le muant en salle d’exposition. Le sourire vissé aux lèvres porté par un regard teinté d’un mélange fait de tristesse et de douceur, Zahra nous guide tout le long de ses dessins trônant sur les sedaris. La jeune femme de 35 ans affiche fièrement son identité de jeblia amazigh et arbore sa fouta rayée de rouge et de blanc, sa sebnia et son chapeau de paille à pompons multicolores. Issue d’une famille de 10 enfants, autodidacte, elle s’adonne, dans son douar natal, à sa passion pour la peinture. Ses thèmes de prédilection sont la vie quotidienne, celle de ses montagnes, des femmes qui l’entourent, des animaux et de la nature. Nul besoin d’autres sources d’inspiration : « il y a trop de belles choses qui m’inspirent autour de moi, je n’ai donc pas besoin de m’évader dans l’abstraction et l’imaginaire », sourit-elle.
Une jeune femme nous scrute du regard tout en remplissant sa meule de grains, une autre, ridée, enfile, comme des perles, les figues qu’elle a séchées, deux femmes chargent une mule avec des ballots de foin qu’elles viennent de constituer…
Les femmes continuent de travailler et défilent sous les verres des cadres, comme ces deux femmes en descente de la montagne, le dos courbés par les fagots de bois sur leur dos ou ces mains qui ramassent des œufs ou encore qui pétrissent la pâte dans un plat de poterie typique de la région. La liste des travaux ruraux effectués par les femmes, figures des tableaux que nous avons sous les yeux, est loin d’être exhaustive.
Ces femmes, véritables piliers de leur société, semblent ne faire qu’un avec le labeur. On les retrouve face à toutes les tâches quotidiennes, harassantes, répétitives : traite des vaches, garde des troupeaux, puisage de l’eau, récolte du fourrage, cueillette des olives, meulage du grain, dressage des meules, construction des fours à pain…
Toutes ces tâches domestiques et extérieures, exécutées à l’infini depuis des siècles se sont fondues dans le paysage rural, en une posture d’invisibilité et de non-reconnaissance absolues. Zahra Ahannach a décidé de mettre fin à cette injustice et réhabilite le travail combien pénible mais combien nécessaire pour assurer, depuis des siècles, l’intendance de millions d’individus. Comme pour mieux répondre à ses aïeules, proches de la nature et de ses fruits, Zahra fabrique elle-même son encre, faite avec l’eau suintant des olives lors de leur phase de désamérisation.
Dans la grande demeure qu’elle habite entourée de son mari et de leurs quatre enfants ainsi que ses parents et quelques membres des dix que compte sa fratrie, Zahra peut compter sur le soutien familial. Ses parents sont fiers d’elle et sa mère évoque une fillette qui a été attirée par le dessin, dès son plus jeune âge. Mais las, dans cette zone reculée, où les montagnes du Rif s’encastrent l’une dans l’autre, elle quittera l’école à l’âge de 12 ans, soit la fin du niveau primaire. Si l’enclavement, les travaux domestiques, l’intendance d’une grande famille ont eu raison de ses rêves d’étude, elle ne s’est néanmoins pas laissé abattre et n’a jamais baissé les bras. Ses rêves, elle les entretiendra, sous une autre forme, la peinture, « sa » peinture « olivée ».
Sous une apparence calme, reposent une force et une volonté d’aller jusqu’au bout de ses rêves et les premières retombées commencent à pointer le bout de leur nez. En effet, elle commence à être connue et donc reconnue, comme l’illustrent les visites fréquentes qu’elle reçoit depuis quelques mois, dont celle d’une célèbre chaîne arabe venue l’interviewer et la faire connaître au grand public. Par ailleurs, dans quelques jours, elle se rendra à Targuist pour y présenter son art lors de l’édition d’un festival qui verra le jour, pour la première fois, dans la ville précitée.
Sans formulation explicite de mots, tout le corps de Zahra porte ce message : « réalisez vos rêves et ne vous mettez aucune limite, ni géographique ni autre ». Zahra a-t-elle d’autres messages à transmettre, par la voie de sa peinture ? Sans aucun doute mais elle laisse la liberté, à chaque personne d’y lire l’idoine, celui qui parle à son cœur.
Ses dessins ne sont pas qu’images, ils sont un langage qui interpelle notre société par la description d’une réalité souvent euphémisée sous les traits de la littérature et des citadins de passage, celle d’un quotidien féminin fait d’oubli de soi, dans l’engagement de care total envers l’autre, l’enfant, l’époux, le voisinage, la tribu…
Merci Zahra de déciller notre regard sur ce travail invisible et éprouvant, réhabilitant ainsi nos aïeules, qui, tout en s’adonnant aux tâches multiformes, ont aussi, mené, à leur façon, des combats pour exister en tant que femmes, se débarrasser de quelques contraintes et relever des défis. En la matière, un vaste travail d’archéologie s’impose et reste à faire pour mettre au. Jour ces combats fossilisés.
*Ecrivaine et ancienne femme politique en Belgique.
Abonnez-vous pour recevoir les dernières nouvelles
Conditions de publication : Les commentaires ne doivent pas être à caractère diffamatoire ou dénigrant à l’égard de l’auteur, des personnes, des sacralités, des religions ou de Dieu. Ils ne doivent pas non plus comporter des insultes ou des propos incitant à la haine et à la discrimination.