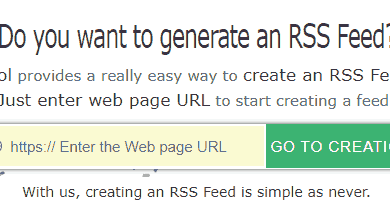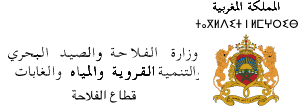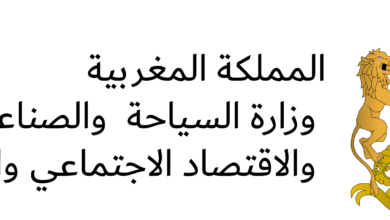[TRIBUNE] Patrimoine législatif marocain : la machine de … – Telquel.ma
Éducation
TQ Impact
Dans cette tribune, l’économiste Mohammed Benmoussa met en exergue un manquement du gouvernement en lien avec sa fonction de production des lois, notant que le patrimoine législatif du Maroc a subi un recul sans précédent depuis octobre 2021. Une sorte de machine méthodique et délibérée de déconstruction de nos lois pour pérenniser la rente multiforme, fragiliser les citoyens ordinaires ainsi que les petites entreprises, et immuniser les justiciables les plus puissants.
La première action symbolique du gouvernement au niveau législatif fut le retrait — osé — en décembre 2021 du projet de Code pénal qui contenait le feu nucléaire pour la mal-gouvernance publique, à travers des articles sanctionnant au pénal l’enrichissement illicite.
Sous prétexte que ce texte devait être plus ambitieux sur les libertés publiques individuelles et collectives, le ministre en charge du dossier rendait ainsi service à ses alliés au pouvoir, qui éprouvaient de l’effroi face à l’épée de Damoclès que représenterait cette nouvelle législation répressive.
Le deuxième recul législatif correspond à la loi-cadre sur la fiscalité, certes votée à la fin de la précédente législature en juillet 2021, mais portée à marche forcée par le ministre de l’Économie et des Finances de l’époque, qui était encarté dans le parti présidé par l’actuel chef de gouvernement.
Il y a donc une certaine continuité dans l’action de déconstruction des lois, d’autant plus que les limites de cette loi-cadre allaient se confirmer à l’occasion de l’adoption des lois de finances 2022 et 2023.
En effet, la loi-cadre a fait l’objet d’un débat expéditif au sein des deux Chambres du Parlement, les transformant ainsi en simples chambres d’enregistrement. Les formulations utilisées par le texte de loi sont trop générales, peu précises et ne présentent aucune contrainte de temps, ni aucun engagement formel des pouvoirs publics pour mener les réformes nécessaires et atteindre un certain nombre d’objectifs concrets et mesurables.
Plusieurs réformes proposées par le Nouveau modèle de développement (NMD) pour garantir l’équité et l’efficacité du système fiscal marocain sont complètement passées sous silence.
Un traitement expéditif similaire fut réservé à la loi-cadre sur la réforme des établissements et entreprises publics (EEP) au cours du mois de juillet 2021 par les mêmes protagonistes. Il en a résulté une série d’incohérences, de contradictions et de régressions par rapport aux recommandations du NMD.
Outre des formulations trop générales dépourvues d’objectifs concrets et mesurables en termes de performance des EEP, la loi-cadre ne prévoit pas de renforcer le rôle de l’État investisseur et développeur, ni ne fait en sorte que le secteur public puisse jouer un rôle décisif dans la transformation stratégique de l’économie marocaine, la stimulation du secteur privé, l’industrialisation du pays ou la conquête de nouveaux marchés internationaux. Cette loi ne met pas en exergue l’objectif de valorisation du patrimoine de l’État, comme elle ignore totalement le rôle des EEP à caractère non marchand.
Enfin, aucune orientation n’est donnée sur la restructuration des différents fonds d’investissement public, ni sur celle du portefeuille public en termes de regroupement d’EEP en pôles ou holdings publics sectoriels homogènes et cohérents.
La loi relative à la création de l’Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’État et de suivi des performances des EEP (ANGSPE), également adoptée en juillet 2021, attribue à l’Agence un positionnement institutionnel pour le moins inadéquat eu égard aux missions qui lui sont assignées, puisqu’elle est placée sous l’autorité directe du ministère de l’Économie et des Finances, qui exerce à l’égard de son directeur général un pouvoir hiérarchique.
Cette configuration institutionnelle constitue à la fois une limite à la nécessaire “hauteur stratégique” et tout autant indispensable “approche systémique et transversale” qui doivent caractériser la politique générale de l’Agence, ainsi qu’une entrave à l’autonomie et l’impartialité qui doivent distinguer l’action de son dirigeant principal.
Limitée à un simple rôle de proposition en matière de définition de la politique actionnariale de l’État, l’Agence n’est pas consultée au cours du processus de nomination des dirigeants des EEP, comme elle n’émet qu’un simple avis sur les contrats programmes que l’État envisage de conclure avec les EEP.
En vertu de la nouvelle loi, le rapporteur général a le pouvoir de faire une proposition de transaction au Conseil de la concurrence (CC) sans aucune limite. Cette ouverture est dangereuse car elle peut conduire à des dérives comme on peut le voir dans les transactions négociées avec l’administration fiscale.
Le seuil de chiffre d’affaires permettant de parler d’une concentration est très significativement augmenté, permettant ainsi à nombre d’opérations “sensibles” de passer entre les mailles du filet. La définition du chiffre d’affaires servant de base de calcul de la sanction en cas d’infraction, a subi une réduction drastique de son périmètre et de son montant, et par conséquent de l’assiette de calcul de la sanction.
Enfin, cette loi maintient l’impunité totale des décideurs personnes physiques au sein des sociétés qui ont commis des infractions, tandis qu’aucune réparation n’est prévue pour le préjudice causé aux consommateurs.
La loi ne définit pas la notion d’intérêts en matière de déclaration d’intérêts et ne l’étend pas au conjoint et aux enfants. Les membres du Conseil de la concurrence ont la possibilité de délibérer dans une affaire où ils ont eu un intérêt si un délai de 5 années s’est écoulé jusqu’à la date de délibération, alors que l’ancienne loi ne prévoyait pas de délai de prescription de l’incompatibilité.
Il est à signaler que le président du Conseil de la concurrence, qui a été président de Lesieur de 2003 à 2009, s’est de lui-même libéré de cette règle avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi en statuant sur le dossier des huiles de table en octobre 2021. La loi ne dit rien sur le cas où c’est le Président lui-même qui est en conflit d’intérêt. Aucune procédure de dépaysement n’est prévue à cet effet.
La nouvelle loi permet au règlement intérieur du Conseil de la concurrence d’attribuer à la commission permanente ou à une simple section des pouvoirs exorbitants qui devraient relever normalement du collège, comme elle donne le pouvoir au président de déroger au règlement intérieur en cas de circonstances particulières et d’affecter directement une affaire à l’une des formations, sans la moindre indication sur la nature de ces circonstances et sur les obligations d’information des autres membres du collège.
Le président du Conseil de la concurrence a aussi le privilège de déroger aux règles normales de quorum et de se contenter de la présence de quatre membres seulement du collège, au lieu de huit, en cas de “saisine urgente”, notion que la loi ne définit pas, ni ne précise ses conditions de recevabilité.
Enfin, la loi engage la responsabilité pénale des membres du Conseil de la concurrence qui dévoileraient le secret des délibérations et des réunions, permettant ainsi de verrouiller des informations sensibles relevant de l’intérêt général.
La loi sur les sociétés régionales multiservices (SRM) ignore le mouvement de remunicipalisation des services publics opéré dans un grand nombre de villes à travers le monde, et perd de vue l’expérience traumatisante de la Lydec et d’Amendis : factures démesurées, remontées aux maisons mères de redevances abusives et de dividendes illégitimes, défaillances techniques…
Ne détenant plus que 10% du capital des SRM, l’État va renoncer à une de ses fonctions régaliennes au profit du secteur privé en lui délégant la fonction de l’expropriation et en perdant la main sur les décisions stratégiques. Ce renoncement de l’État sera organisé dans l’opacité la plus totale, puisque l’attribution des concessions de service public aux SRM se fera par entente directe, sans procédure d’appel d’offres. Enfin, le principe de l’équilibre financier est érigé en règle de gestion des SRM, considérant que l’accès à l’eau, l’électricité et l’hygiène n’est plus un droit garanti par l’État mais un bien marchand répondant à la loi de l’offre et de la demande et aux critères purement financiers.
La création d’une Commission provisoire de gestion des affaires de la presse met sous tutelle administrative le “quatrième pouvoir”, censé être indépendant des trois autres pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire. Elle proroge dans les faits et sans aucune légitimité la durée de mandat des principaux dirigeants du bureau actuel du Conseil national de la presse, constitue une ingérence dans les affaires intérieures d’une profession sensible et foule du pied les principes les plus élémentaires de la démocratie.
Pour parvenir à déconstruire le patrimoine législatif du Maroc en si peu de temps, il aura fallu obtenir une connivence entre le gouvernement et le Parlement. C’est désormais chose faite. Cela a été rendu possible à la suite de l’intrusion de l’affairisme dans la vie politique nationale, qui a pu prospérer grâce à la présence de quatre adjuvants : une forte dose d’abstentionnisme, une grande masse de votants sensibles aux paniers alimentaires et autres formes d’incentives, des médias muets et, disons-le, une certaine indifférence de l’État à l’égard de ces pratiques électorales moyenâgeuses.
Cette dramatique situation rend plus que jamais nécessaire l’émergence d’un nouveau modèle politique. Mais notre pays saura-t-il trouver les Hommes et Femmes d’État capables de porter cette émergence ?