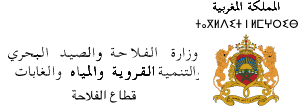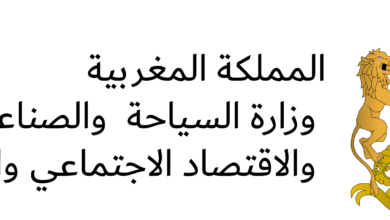#Reconstruire_après_la_tragédie : Une conversation avec Adnane … – Maroc Hebdo
En continu
#Reconstruire_après_la_tragédie : Une conversation avec Ad…
La visite du président Macron au Maroc, ni à l’ordre du jo…
Fonds spécial séisme : Déjà plus de cinq milliards de di…
Tragédie d’Al-Haouz : AFRIQUIA SMDC et AFRIQUIA GAZ du gr…
Tragédie d’Al-Haouz : Le SNPM dénonce l’abjecte campag…
Adnane Addioui se définit comme un entrepreneur social.
En mai 2012, il avait créé le Centre marocain pour l’innovation et l’entrepreneuriat social (MCISE), qui, depuis lors, a accompagné aussi bien au Maroc que dans une dizaine d’autres pays des milliers de jeunes et de femmes porteurs de projets associatifs et d’entrepreneuriat pour passer de l’idée à l’action.
On se souvient également de lui comme un des trente-cinq membres de la commission Benmoussa, installée en décembre 2019 par le roi Mohammed VI en vue de concevoir le nouveau modèle de développement (NMD).
Situation exceptionnelle oblige, le MCISE s’est transformé, depuis le séisme du 8 septembre 2023, en “war room” d’urgence. A l’image d’autres organisations nationales comme par ailleurs internationales, il participe à l’effort qui vise à assurer aux populations affectées les premières aides dont elles ont besoin, tout en coordonnant au plus près possible avec les acteurs présents sur le terrains. Avec, ceci dit, quelques particularismes propres, comme on le verra plus bas, au centre.
Mais le MCISE est également orienté vers l’avenir un peu plus lointain. Celui qui doit, en fait, permettre de pérenniser la reconstruction des zones sinistrées, dans le cadre d’un modèle où l’autonomie de ses populations devra être la règle.
“Les aides en nourriture, en couvertures, elles sont bien évidemment importantes, étant donné que les gens doivent se nourrir aujourd’hui et demain,” souligne M. Addioui, à l’instar d’autres interlocuteurs avec qui, pour cette série d’articles, Maroc Hebdo a été en contact. “Mais pour après-demain, ce ne sera pas suffisant et même, au contraire, contre-productif. Comme nous sommes par exemple chaque année témoin avec ce qu’on appelle les caravanes de donation dans l’Atlas, l’hiver finit toujours par arriver”.
En premier lieu, M. Addioui salue la dynamique exceptionnelle enclenchée au sein de la population marocaine, qui, on l’a vu, n’a pas lésiné sur les moyens pour contribuer à ce que ceux qui se trouvent dans les régions où le séisme a eu le plus d’impact puissent relever la tête. Pour lui, il faudra que, même lorsque l’émotion sera redescendue, cela continue, du fait que, croit-il, “l’Etat ne réussira pas à lui seul la reconstruction”.
“La reconstruction physique, éventuellement des bâtiments,” poursuit-il. “Mais quid du tissu socio-économique, où dans certaines zones il a aussi été réduit à néant, à l’image des habitations?”
En s’appuyant sur l’expérience du MCISE, M. Addioui pense que le mieux sera, pour pouvoir inscrire la reconstruction sur la durée, d’axer le tout sur le local. C’est-à-dire qu’il faudrait par exemple à ses yeux, pour commencer, déjà que tous les travaux qui seront menés le soient par une main d’œuvre locale. “Vous savez que même pour les couvertures qu’on s’est chargé d’acheter pour les zones sinistrées, nous avons eu recours à des coopératives plutôt qu’à des industriels établis, car pour nous toute la vision doit nécessairement être transversale et ne pas seulement être axée sur certains outputs de portée réduite,” indique M. Addioui.
Et c’est dans cette même logique qu’il appelle à mettre à profit le processus en cours pour revoir l’ensemble des modes de production pas seulement dans les zones sinistrées, mais sur la totalité du pays. Plus concrètement, M. Addioui met l’accent sur le fait de, tout d’abord, identifier les besoins des régions, et, à partir de là, mettre en place des unités de production situées dans ces mêmes régions qui puissent répondre à ces besoins. “C’est le modèle de la production locale,” expose-t-il. “C’est ce qui a permis à des pays comme les Etats-Unis, le Japon, de devenir ce qu’ils sont aujourd’hui, c’est-à-dire de grandes puissances industrielles mondiales. Et c’est quelque chose qu’on peut, en fait, implémenter dès maintenant pour les travaux de reconstruction. Pour les matériaux qui seront utilisés, on peut les produire localement, et cela permettra aussi, comme vous pouvez l’imaginer, que les populations concernées puissent bénéficier d’un travail si on reste dans la même logique que j’ai détaillé auparavant.”
Mais dans le modèle de M. Addioui, il n’y a pas de place que pour l’économie. Au cours de l’échange que nous avons avec lui, la conversation s’arrête à un moment sur la question de la mise en valeur des patrimoines locaux. A ce titre, M. Addioui propose de faire bénéficier les populations des zones sinistrées de formation adéquates. “Il faut respecter les identités,” plaide-t-il. “C’est l’essence même. On ne peut pas parler de régions sans que leurs identités aient droit de cité, en se contentant seulement d’aborder les seules problématiques d’ordre économique”.
Maintenant comment, si on est convaincu par l’approche de M. Addioui, aider? Pour poursuivre le plan élaboré par ses soins, le MCISE a, naturellement, besoin de financements. Outre les produits de première nécessité, le centre s’est également chargé d’acquérir des lampes et des batteries solaires, des serviettes menstruelles pour les femmes et d’autres produits importants pour le quotidien au profit des populations sinistrées. Mais le MCISE aura également besoin de bénévoles pour l’aider.
Du reste, M. Addioui a insisté, à différentes reprises, sur la question du partage par l’Etat des informations dont il dispose. “On parlait tout à l’heure de l’identification des besoins locaux, comment le faire sans ces informations?,” s’interroge-t-il. Et de citer l’exemple de la Libye. Par le moyen des satellites, on peut, déclare M. Addioui, avoir une idée plus ou moins précise des dégâts causés par la tempête Daniel. Et cela permet, par conséquent, de rendre plus efficace l’aide. “Par rapport à la reconstruction physique de ce qui a été détruit par le séisme, sans données il sera difficile pour les citoyens de savoir ce qu’il reste à faire, les champs d’action que les pouvoirs publics laisseront de côté,” avertit-il.
© Maroc Hebdo. Tous les droits sont réservés