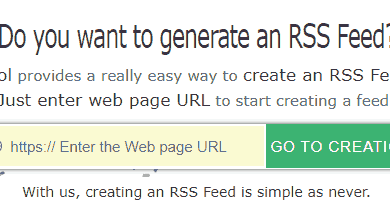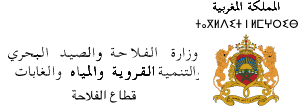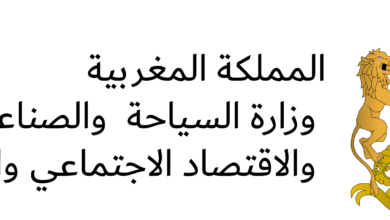Moyen-Orient – Afrique du Nord – L'intégration commerciale … – Etudes économiques du Crédit Agricole
Le constat est sans appel : le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord forment la région du monde où l’intégration commerciale régionale est la plus faible. Les pays commercent principalement avec les pays européens et asiatiques et très peu entre eux, y compris avec les pays de leur voisinage proche.
Les statistiques sont sans conteste très parlantes : le commerce intra-régional ne représente que 10% des échanges de biens. À titre de comparaison, 40% à 60% des échanges commerciaux au sein de l’Union européenne se réalisent entre les pays partenaires de l’UE, où la libre circulation des biens et des personnes est l’un des piliers économiques fondateur de l’union et plus encore entre ceux de la zone euro où l’unité monétaire a fortement dynamisé les relations intra-zone. Une situation par ailleurs confirmée par la forte intégration commerciale des pays d’Europe de l’Est avec les pays de l’UE. Les échanges des biens entre eux atteignent 60% du total. En Asie, l’intégration des pays par le canal du commerce interrégional est également très élevée car la complémentarité industrielle y est assez forte. Ainsi 49% des échanges commerciaux se réalisent entre les pays de l’ASEAN et ceux de l’ASEAN élargi. À part le Mexique, plus intégré aux États-Unis, les pays d’Amérique latine commercent entre eux à hauteur de 15% à 33% de leurs échanges, un pourcentage qui monte à plus de 50% pour les pays enclavés, ne disposant pas de façade maritime.
La situation très particulière du Proche-Orient qui consiste en la quasi-absence de commerce avec ses voisins existe depuis de très nombreuses années et aucune évolution majeure n’est constatée. Parfois, les échanges intra-zone ont même diminué depuis quelques années.
Il existe néanmoins un certain nombre de pays un peu mieux intégrés que la moyenne dans la zone. Tout d’abord, l’Égypte, dont l’économie est plus diversifiée que la moyenne régionale en termes d’exportations et se distingue par la présence d’une nombreuse diaspora dans les pays du Golfe. Ainsi 20% des flux commerciaux de l’Égypte (importations et exportations) sont réalisés avec des pays du Proche-Orient. La Jordanie, pays enclavé où l’agriculture joue un rôle important dans les exportations, réussit à exporter un tiers de ses produits dans son voisinage proche. Une situation que l’on retrouve aussi dans le cas du Liban pour les exportations. Et enfin l’Iran, pays à l’économie plutôt diversifiée, qui ne commerce régionalement qu’avec pratiquement trois pays de son voisinage : l’Irak, les Émirats et Oman, et ce à hauteur de 20% de ses exportations et d’un tiers de ses importations (presque exclusivement en provenance des Émirats).
Entre les six pays du Golfe, les échanges commerciaux sont un peu plus intenses qu’ailleurs dans la région. C’est notamment le cas du Koweït ou de l’Arabie pour les importations (16% et 23%) et des Émirats dont la fonction de réexportation régionale est assez élevée (21% du total). Malgré tout, ces pourcentages restent très modestes comparés aux autres régions du monde. En fait, les pays du Golfe les plus ouverts commercialement ont traditionnellement des relations assez développées avec les pays du sous-continent indien et d’Asie, une tradition liée au commerce maritime et qui date du Moyen Âge.
En revanche, l’absence d’intégration commerciale régionale est encore plus flagrante pour les pays du Maghreb : les relations commerciales sont au plus bas, voire quasi inexistantes entre le Maroc et la Tunisie. L’Algérie ne commerce pas non plus avec ses deux voisins (cf. les explications ci-dessous).
Au total, on constate donc un très fort contraste avec les économies intégrées d’Asie, d’Europe et d’Amérique du Nord. C’est une situation particulière qui interroge.
Les raisons sont effectivement anciennes et multiples. D’une part, la région se caractérise par son économie très rentière, orientée en premier lieu sur les matières premières énergétiques et donc avec un faible niveau de diversification des productions. 61% des exportations régionales en valeur sont assurées par les matières premières énergétiques et sont donc orientées vers les grands marchés consommateurs mondiaux que sont les pays développés européens et les grands importateurs asiatiques. Le corollaire de cette situation est la quasi-absence de complémentarités des produits industriels usinés localement.
L’industrialisation de la région est d’ailleurs assez faible, y compris dans les pays producteurs de pétrole pour lesquels la pétrochimie et la production d’aluminium sont les principales productions hors pétrole et gaz. La valeur ajoutée y est donc contrainte. Par ailleurs, la culture entrepreneuriale et le poids des entreprises privées dans la production sont généralement moins développés dans de nombreux pays de la région où les structures étatiques pèsent encore beaucoup dans l’activité économique.
Autre obstacle à une meilleure intégration : les lacunes régionales en termes d’infrastructures de transport. Elles sont assez profondes et, régulièrement, pointées du doigt par de nombreux observateurs comme la Banque mondiale ou l’OCDE. Elles concernent principalement les routes et les réseaux de transport d’énergie, mais aussi les technologies de l’information et de la communication. En termes de transport public, les déficiences sont également importantes dans de nombreuses villes. Nombreux sont les exemples de projets de connections interétatiques qui n’ont jamais vu le jour comme le train Muscat-Dubaï-Abu-Dhabi ou l’autoroute transmaghrébine, inachevée au niveau des frontières entre pays d’Afrique du Nord. Les défaillances de transport, parfois exacerbées par l’indisponibilité de certaines routes commerciales en cas de conflit, ne favorisent pas, bien évidemment, le commerce des biens et des services.
Il faut aussi citer les tensions géopolitiques entre pays qui sont assez récurrentes et constituent un frein aux relations commerciales à long terme. Les détroits maritimes (Ormuz, Bab-el-Mandeb) et les infrastructures de transport sont parfois l’objet d’enjeux de puissance et donc générateurs de tensions. De plus, les frontières fermées sont nombreuses dans la région, même en dehors des zones de conflit comme la frontière Maroc-Algérie ou celle entre la Libye et l’Égypte.
Par ailleurs, des taxes douanières pénalisantes constituent souvent des barrières commerciales rigides. Les politiques commerciales inter-États sont parfois « punitives » (comme parfois le blocage des exportations pour soutenir la consommation locale) et elles perturbent donc le bon déroulement de la marche des affaires.
Enfin, le commerce international est aussi souvent utilisé comme une arme politique ou géopolitique comme l’ont illustré récemment les embargos contre le Qatar de 2017 à 2021 ou contre le Liban en 2021, ou encore récemment la rupture des relations entre le Maroc et l’Algérie, en raison des tensions sur la question du Sahara occidental. Ces exemples paraissent plus fréquents dans la région Moyen-Orient – Afrique du Nord que dans d’autres régions du monde où les tensions interétatiques n’aboutissent pas forcément à une rupture brutale des relations commerciales entre États.
Ce qui est vrai des marchandises et des services l’est aussi en grande partie pour les personnes. La région se partage ainsi en deux zones bien distinctes et assez clairement identifiées : les ressortissants de l’un des six pays du Golfe (Arabie, Bahreïn, Émirats, Koweït, Oman et Qatar) peuvent se déplacer assez largement dans les pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord sans nécessité de visa. Ailleurs dans la zone, c’est l’inverse qui prévaut : la circulation des habitants des autres pays est rendue très difficile par l’obligation de visas dont la délivrance n’est pas toujours systématique. Ainsi, un ressortissant marocain devra disposer d’un visa préalable pour voyager dans onze des dix-huit pays de la région quand un Émirati n’aura besoin que de six visas (trois préalables et trois obtenus à l’arrivée). L’obligation de visa pour se déplacer est bien sûr encore plus vraie pour les habitants des pays en guerre (Irak, Syrie et Yémen).
Les conséquences d’un très faible commerce intra-zone sont dommageables pour l’ensemble de l’économie. D’une part, les marchés domestiques sont trop étroits et brident significativement la croissance économique en l’absence de dynamique commerciale endogène. La région ne génère donc que peu d’économies d’échelle en l’absence de complémentarités. La croissance est en outre souvent trop volatile car excessivement liée aux rentes des matières premières ou du tourisme. Et ces économies disposent de trop peu d’amortisseurs en cas de crise. Par ailleurs, hors pays du Golfe, les investissements directs étrangers (IDE) sont assez contraints ou alors souvent utilisés comme des aides ponctuelles ou des mesures de sauvetage des pays riches du CCG lors de crises financières (comme récemment en Tunisie, en Égypte et, au cours des précédentes crises d’avant 2019, au Liban).
Au total, si le déficit de complémentarité industriel et commercial et le manque de diversification économique dans la région sont bien les principaux facteurs qui brident les échanges intra-zone et donc le développement économique, des tensions plus politiques et géopolitiques fréquentes freinent significativement l’intégration commerciale. Un autre exemple malheureux du caractère peu inclusif du développement économique de la région.
Article publié le 26 mai 2023 dans notre hebdomadaire Monde – L’actualité de la semaine
Des espoirs existent malgré tout avec les accords d’Abraham et l’intégration régionale d’Israël, la construction d’oléoducs ou de gazoducs au Moyen-Orient pour développer les champs gaziers méditerranéens ou contourner les détroits, les récentes mesures prises par les Émirats pour mieux s’intégrer dans l’économie mondiale, l’ouverture progressive de l’Arabie au tourisme non religieux et l’apaisement récent des relations des pays arabes avec l’Iran, et notamment de l’Arabie saoudite. Bien que la région soit sujette aux tensions récurrentes, la volonté politique régionale d’un développement industriel plus vigoureux afin de susciter une meilleure intégration commerciale existe probablement plus que dans le passé.
Consulter l’article
pour toute demande
Recevez vos abonnements directement sur le site ou par mail
©2023 Crédit Agricole