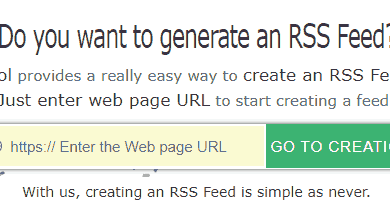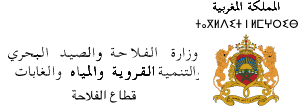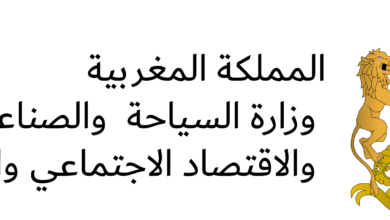Les dangers d'un enlisement de la dette au Maroc – Maroc Hebdo
En continu
1ère Commission nationale des investissements: 21 projets a…
Rabat: La police enquête sur la vidéo virale de l’agress…
Fès : l’agence urbaine présente son rapport financier…
Sous l’impulsion de SM le Roi, le Maroc a fait de l’intégra…
Anniversaire de l’OUA: Quand Mohammed V réunissait les lead…
L’endettement est un sujet quasiment tabou dans les hautes sphères de décision économique. Considérant que les fondamentaux sont solides et que l’équilibre des grands agrégats est stable, les responsables du budget n’hésitent pas à augmenter l’encours auprès des institutions financières internationales afin de financer leurs programmes. Si le postulat de départ n’est pas tout à fait faux, la volatilité de la conjoncture internationale remet en cause certaines certitudes.
En recoupant les estimations des différents bureaux d’étude et d’analyse, la dette du Trésor marocain devrait poursuivre son trend haussier en 2023, dépassant les 1.000 milliards de dirhams, contre 956 MMDH en 2022. Le Trésor devrait maîtriser son déficit budgétaire en 2023 à 65,7 Mds, soit environ 4,5% du PIB. Dans le détail, la dette intérieure devrait atteindre 760 Mds en 2023, en hausse de 1,8% par rapport à 2022, alors que la dette extérieure devrait augmenter de 25% passant de 209 Mds en 2022, à 262 Mds en 2023, précise la même source. Tenant compte des prévisions de croissance de la Loi de finances (LF) pour l’année 2023, le Trésor devrait afficher un ratio d’endettement de 70% en 2023. Ce ratio aurait atteint 66,7% en février 2023. À fin février 2023, la dette globale aurait atteint 974 Mds.
La composante intérieure est estimée à 763 Mds, contre 211 Mds pour la composante extérieure. Au final, le poids de la dette extérieure dans l’endettement global du Trésor devrait se situer autour de 26% au cours de l’année 2023. Il faut certes contextualiser. Les économies du monde entier connaissent une hausse vertigineuse de leur dette. A commencer par la première puissance mondiale, les Etats-Unis d’Amérique. Si aucun accord n’est trouvé au Congrès américain pour rehausser le plafond de la dette, les États- Unis pourraient se retrouver en défaut de paiement dès le 1er juin. Officiellement, le plafond d’endettement fixé par le pays (31 381 milliards de dollars) a déjà été atteint le 19 janvier 2023, mais le gouvernement a obtenu un sursis grâce à des mesures d’exception. Une comparaison directe avec les pays de l’Union européenne montre à quel point la dette publique des États-Unis est énorme. Au total, les 27 pays membres de l’UE cumulent 13 273 milliards d’euros de dette à la fin de l’année 2022 (dont 2 950 milliards d’euros pour la France).
Fréquentes critiques
Cela correspond à moins de la moitié de la dette américaine à la même date. Exprimée en pourcentage du PIB, la dette des États-Unis dépasse actuellement les 120 % (contre environ 110 % pour la France). Toutefois, les Etats-Unis peuvent se permettre un tel creusement de l’encours de leur dette pour deux raisons principales : la force de leur monnaie qui constitue l’étalon des échanges internationaux, et la performance de leur économie qui génère un PIB annuel de 29,9 trillions de dollars. A son niveau, le royaume est dans l’obligation de maintenir un ratio soutenable au vu de la faiblesse de la croissance de son PIB (1,2% en 2022). Surtout, celà met clairement en sursis les politiques sociales envisagées. Alors que le projet gouvernemental est celui de mise en place d’un “Etat social”, avec comme objectif le projet royal de généralisation de la couverture sociale aux populations les plus fragiles, l’engagement auprès d’institutions comme le FMI pourrait s’avérer problématique.
De fréquentes critiques adressées au FMI considèrent que ses interventions dans les pays en développement ont aggravé la pauvreté et les dettes des pays aidés en supprimant ou diminuant la capacité d’intervention de ces États. Leur argument principal se base sur le fait que le FMI, via les conditions imposées pour l’octroi de ses prêts, a eu tendance à préconiser les mêmes recommandations économiques et globalement les mêmes plans d’ajustement structurel à tout pays demandeur d’aide, sans analyser en profondeur la structure de chacun.
Sur la base de ce qui a été dénommé le « consensus de Washington », il aurait ainsi systématiquement préconisé une plus grande ouverture aux capitaux étrangers et au commerce mondial de biens et services, la privatisation des entreprises publiques ainsi que l’austérité budgétaire. Selon certains, les exigences du FMI envers des pays en développement auraient entravé la réforme des terres agricoles tout en contribuant à accroître les exportations des denrées alimentaires, et seraient ainsi en partie responsables de l’aggravation de la pauvreté, des flux migratoires vers les villes, et de l’émigration.
© Maroc Hebdo. Tous les droits sont réservés