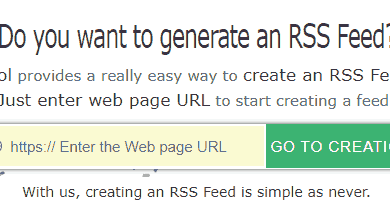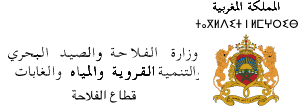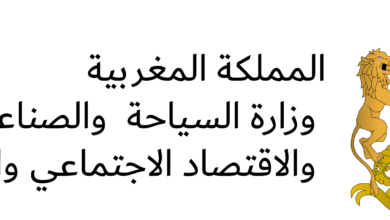Le Maghreb est-il africain ou arabe ? – Courrier international
Cette question identitaire se pose avec force alors que les réfugiés subsahariens sont confrontés dans les pays d’Afrique du Nord à un violent racisme, souvent institutionnel. Pourquoi ces pays ont du mal à se considérer comme africains, s’interroge l’universitaire marocaine Maha Marouan, professeure agrégée d’études féminines et d’études africaines à l’université d’État de Pennsylvanie.
La multiplication des comportements violents, racistes et xénophobes envers les migrants “subsahariens” sans papiers en Libye et en Tunisie est particulièrement inquiétante.
Il devient urgent d’examiner le discours complexe, et souvent dangereux, qui imprègne la société nord-africaine sur les questions d’identité culturelle, de colonialisme et de racisme.
Ce discours, et la violence qui en découle, ne date pas d’hier. Mais, il y a peu, le président tunisien, Kaïs Saïed, a accusé ces populations (c’est-à-dire les migrants clandestins venus d’Afrique centrale et occidentale) de vouloir “faire de la Tunisie seulement un pays d’Afrique et non pas un membre du monde arabe et islamique” – comme si l’identité africaine était incompatible avec l’identité arabe ou musulmane.
En affirmant cela, il omet volontairement le fait que de nombreuses personnes, sur ce continent, se sentent à la fois arabes et africaines, africaines et musulmanes, voire les trois à la fois.
Ceux qui présentent les Noirs comme des étrangers en Afrique du Nord (comme si cette couleur de peau avait été apportée par l’esclavage et constituait un déshonneur) ne font que renforcer l’idée – fausse – que l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne seraient deux entités distinctes sur les plans ethnique et culturel.
Ce discours, qui stigmatise les populations d’Afrique centrale et occidentale (et invisibilise les peuples du Sahel), doit être remis en question de toute urgence. D’autant plus qu’il a désormais des répercussions directes sur le quotidien des migrants en Tunisie et en Libye.
La mise au ban de ces individus s’inscrit dans un discours plus général qui vient consolider le mythe de l’homogénéité raciale et ethnique de l’Afrique du Nord (qui serait peuplée d’Arabes, non noirs) et encourage la stigmatisation des populations locales à la peau sombre.
Ces théories font aussi écho à l’image que de nombreux Africains du Nord ont d’eux-mêmes : ils se considèrent comme Moyen-Orientaux avant tout, oubliant ainsi certaines facettes historiques, culturelles et territoriales de leur identité, qui les lient à l’Afrique.
Nous sommes nous aussi originaires de ce continent, et entretenons des liens ancestraux avec nos voisins des autres régions africaines. Ce sentiment d’appartenance au Levant, bien que sans fondement historique, ne fait qu’encourager la violence à l’encontre de populations déjà très précaires qui sont pourtant plus proches de nous, d’un point de vue ethnique, que nous ne voudrions bien l’admettre.
Ces idées font également ressurgir une vieille tradition de classification raciale et ethnique. À l’époque coloniale, la réorganisation des frontières africaines s’est accompagnée d’un processus de réinvention des populations.
Comme d’autres puissances européennes, la France étudiait les peuples africains par le prisme du darwinisme social, bien résolue à désafricaniser les Africains du Nord (dont la plupart étaient des Amazighs natifs du continent) pour en faire des Arabes, tandis que les populations vivant au sud du Sahara se voyaient classées dans la catégorie des Africains et des Noirs.
Les Britanniques ont tenté eux aussi de coller des étiquettes raciales aux Africains du Nord : leur rapport contre l’esclavage qualifiait ainsi les Marocains – à l’exception des habitants de Fès, qui sont blancs – d’individus noirs, en notant toutefois que certains de leurs dignitaires arboraient “une teinte guinéenne sombre”. Une preuve supplémentaire de l’arbitraire des catégories établies par les colons pour classifier les Africains.
Plusieurs décennies plus tard, ces pratiques n’ont pas disparu et servent à justifier le racisme et la xénophobie dans la région. La distinction entre Arabes et Africains, autrement dit entre Arabes et Noirs, inventée par les colons français, reste d’actualité au XXIe siècle.
Ce faisant, il était difficile de ne pas relever l’hypocrisie des médias français qui se sont insurgés contre les propos problématiques de Kaïs Saïed. J’ai été stupéfaite de les voir critiquer son racisme envers les Noirs – alors que le président tunisien ne faisait que reprendre à son compte les distinctions raciales imaginées et utilisées par les colons français.
Saïed a donné aux médias français exactement ce dont Paris avait besoin : une occasion de (ré) introduire des divisions raciales et ethniques sur le continent africain, selon le principe “diviser pour mieux régner”, qui fut sa stratégie numéro un lors de la colonisation.
Cela n’excuse en rien le racisme et la xénophobie des pays d’Afrique du Nord, loin de là. Mais les déclarations de Kaïs Saïed n’auraient pas pu mieux tomber [pour le gouvernement français], dont l’influence et le prestige sont en plein déclin dans la région.
Depuis quelques années, l’étiolement de l’influence française dans ses anciennes colonies est en effet de plus en plus manifeste, notamment en raison de l’intensification des échanges commerciaux intercontinentaux, qui permet aux pays africains de s’émanciper de l’économie hexagonale.
Tout a commencé par un documentaire, La Reine Cléopâtre, sorti le 10 mai sur Netflix. Une partie de la presse arabe, notamment égyptienne, s’indigne de la représentation de la reine d’Égypte en femme noire. Un parti pris historique que beaucoup d’Égyptiens dénoncent, y voyant une réécriture “afrocentriste”, relate Arab News.
Aucune des statues que l’on a retrouvées de Cléopâtre, qui a régné de 51 à 30 avant J.-C., “ne laisse penser qu’elle était noire”, s’insurge ainsi l’ancien ministre du Tourisme et des Antiquités égyptien, Zahi Hawass. Selon lui, les origines de la reine sont évidentes : “Comme en attestent de nombreuses sources, elle descendait d’un général macédonien contemporain d’Alexandre le Grand. Sa langue maternelle était le grec, et sur les portraits et bustes d’époque, elle est clairement représentée avec la peau claire.”
Dans sa tribune publiée par Arab News, il estime que les récriminations des Égyptiens ne sont pas motivées par du racisme mais “par le sentiment d’être plus ou moins dépouillés de leur identité culturelle”.
Un avocat est même allé jusqu’à déposer plainte auprès du procureur général d’Égypte, rapporte le site d’information égyptien Masrawy. Mahmoud El-Semary exige que la justice prenne des mesures pour mettre fin à la diffusion de “toute œuvre visant à déformer et à effacer l’identité égyptienne”.
Cette catégorisation raciale est anachronique, affirme de son côté le britannique The Observer. Selon le chroniqueur Kenan Malik, “la question de la couleur de peau [de Cléopâtre] – et la réponse que nous y apportons – en dit bien plus long sur nous, notre monde, et la confusion qui règne autour des questions d’appartenance ethnique et d’identité que sur Cléopâtre elle-même et le monde dans lequel elle a vécu”.
Le président Emmanuel Macron a bien tenté de redorer le blason de son pays en mars dernier, lors de sa “tournée africaine”, mais il n’a suscité qu’une vague massive d’opposition et de manifestations. Tout en appelant de ses vœux une relation plus équilibrée avec l’Afrique, par le biais de “nouveaux partenariats”, il a bien fait comprendre – comble de l’ironie – qu’il n’avait aucunement l’intention de mettre fin aux pratiques coloniales de son pays.
Le chef d’État avait déjà tenté, en vain, de réaffirmer la puissance française l’an dernier, lors du sommet de l’Organisation internationale de la francophonie. Ce dernier s’était déroulé sur fond de récriminations de plus en plus fortes contre les méthodes coloniales de Paris, notamment ses interventions militaires dans la région, ses politiques financières spoliatrices, et sa mainmise sur les ressources naturelles du continent.
Mais cela n’avait pas suffi à décourager Emmanuel Macron – à moins qu’il refuse tout simplement de déchiffrer les signes. Le président français avait poursuivi son discours colonialiste, allant même jusqu’à qualifier le français de vraie langue universelle du continent et de langue du panafricanisme !
Malgré tout cela, il reste quelques raisons d’espérer. La mobilisation en cours pour défendre les droits des exilés africains en Tunisie et en Libye est encourageante. La seule issue possible est de toute évidence l’instauration d’une politique publique axée sur ces droits – et, sur ce plan, le Maroc a une longueur d’avance.
Il y a presque dix ans, en réaction aux vagues de violence contre les immigrés d’Afrique de l’Ouest, Rabat s’est lancé dans une politique migratoire globale – une première dans la région –, qui a conduit à la régularisation de 25 000 sans-papiers en 2014, puis de 25 000 autres trois ans plus tard.
Pour autant, le Maroc est loin d’être un eldorado. D’autres réformes sont nécessaires, car les clandestins arrivés après 2017 ont encore beaucoup de mal à se faire régulariser. Mais l’exemple marocain en est la preuve : la mise en place de mesures destinées à défendre les droits des migrants est la première étape pour freiner et déjouer la violence.
Par ailleurs, les politiques restrictives des pays européens font grimper le nombre de candidats à l’exil dans le Nord de l’Afrique, rendant indispensable l’adoption d’une politique migratoire inclusive et durable. Espérons que les enquêtes en cours dans les centres de rétention et sur les actes de violence envers les migrants en Libye permettront de sensibiliser l’opinion publique à ces enjeux.
Nous ne pouvons pas nous permettre de verser dans la xénophobie et l’hypocrisie. Étant nous-mêmes (Marocains, Algériens et Tunisiens) fortement concernés par l’exode – un tiers de nos concitoyens résident actuellement en Europe –, nous n’avons nullement le droit de mépriser les émigrés venus d’autres pays africains, ni de contester leur droit à l’exil.
Cette universitaire marocaine, professeure agrégée, enseigne les questions de genre, de sexualité et d’études africaines à la Pennsylvania State University. Ses travaux portent essentiellement sur les questions liées au féminisme du Sud, la littérature africaine féministe, les relations globales Nord-Sud. Ses champs de réflexion portent également sur les questions religieuses, l’étude de l’immigration et les diasporas africaines.
En plus de l’enseignement, de l’écriture et la réalisation de documentaires, Maha Marouan dirige le Centre pour le féminisme africain, qui s’intéresse principalement aux études féministes sur le continent africain.
L’Afrique du Nord n’est pas confrontée à une présence “étrangère”, comme voudrait le faire croire Kaïs Saïed, mais à une présence “familière”. La frontière entre ce que nous appelons le Nord et les régions subsahariennes (sans exclure le Sahel) a toujours été souple et perméable.
Et c’est justement cette perméabilité qui nous permet de résister à la fracture entre Arabes et Africains instaurée par les puissances coloniales.
Maha Marouan
Lire l’article original
États-Unis. À New York, le stand-up se met à nu
Vu du monde arabe. L’accord de 1968 sur l’immigration algérienne est-il “injustifié” ?
Russie. Prigojine : ce que savaient les agences de renseignement américaines
Arrestations. En Syrie, la Russie a lancé une purge contre Wagner
Créé en 2009 par l’universitaire sud-africain Sean Jacobs, Africa Is a Country (L’Afrique est un pays) est un site d’information sur l’actualité africaine. Son objectif est de remettre en cause les traditionnels stéréotypes répandus dans les médias occidentaux sur les 54 pays africains. Cette plateforme accueille de nombreux intellectuels africains et revendique une orientation politique de gauche.
Vu de l’étranger . “La France sur un brasier” : les violences se propagent à travers l’Hexagone après la mort de Nahel
Environnement. En Chine, une réserve naturelle où les rapaces tombent comme des mouches
Mutinerie. L’armée russe à l’heure d’une purge “massive et aveugle”
Société. Grâce à la génération Z, nous ne travaillerons plus comme avant