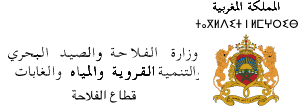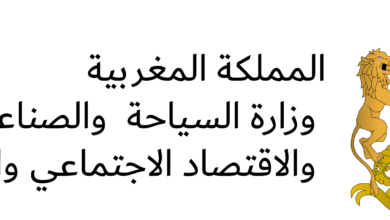Faute d'eau, la politique agricole en question – Maroc Hebdo
En continu
“Le Maroc, un musée archéologique à ciel ouvert”: la pass…
La formation professionnelle, nouveau terrain de collaborati…
Attentats de Madrid: les délires anti-marocains d’un ex-c…
Ouverture de la 15è édition du Festival de tbourida à El …
Eric Ciotti: la souveraineté du Maroc sur le Sahara est ind…
En quinze ans, le Royaume est devenu une véritable puissance agricole régionale. Mais à quel prix écologique? Faute de ressources hydriques suffisantes, il sera peut-être bien obligé de revoir ses choix stratégiques. Au risque de courir tout droit à la catastrophe.
En février 2022, la mort du petit Rayane, 5 ans, avait fait les grands titres des journaux nationaux et internationaux (lire n°1427, du 11 au 17 février 2022). En jouant à côté d’un puits creusé par son père non loin du domicile de la famille à Ighrane, dans la province de Chefchaouen, il y était tombé. Les efforts mis en oeuvre cinq jours durant par les autorités n’avaient pas permis de le sauver. Tandis que l’émotion emplissait les foyers marocains, certains experts faisaient remarquer un point alarmant, sans qu’on lui ait sans doute prêté toute l’attention qu’il fallait: que le puits où Rayane avait rendu l’âme était trop profond.
En effet, il mesurait 32 mètres; ce qui n’est pas rien quand on sait que la région concernée, qui est située sur le flanc ouest des montagnes du Rif, est normalement bien pourvue en eaux souterraines: avec parfois jusqu’à 2.000mm de précipitations par an, ses nappes phréatiques font partie des plus importantes du Maroc. Et quand bien même, le puits était à sec. Petit exploitant agricole à la base, le père de Rayane n’avait ainsi, faute de moyens, pu aller plus bas et avait d’ailleurs commencé depuis un certain temps, au moment du drame, à s’adonner à différents petits boulots dans les villages du voisinage pour pouvoir nourrir les siens.
Nouvelles variétés
S’il avait voulu avoir gain de cause, il lui aurait peut-être fallu descendre, selon les différents avis, à au moins 100m, voire même 400m (!): ainsi est, depuis plusieurs années, le lot de nombreux fermiers de la province de Chefchaouen mais aussi celles, voisines, d’Al Hoceima et Taounate. La faute à la culture du cannabis. Bien qu’antique, cette dernière est actuellement, pour reprendre un propos tenu en avril 2021 par le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, à la chambre des représentants, en train de provoquer un “drame environnemental”; conséquence de l’utilisation de nouvelles variétés autrement hydrovores que la “beldiya”, la traditionnelle. On pense notamment à la fameuse “khardala”, une plante génétiquement modifiée introduite au tournant des années 2010 et dont les agriculteurs sont friands du fait de sa forte rentabilité due à sa haute teneur en THC, le principe actif du cannabis (pas moins de 25% de la résine séchée, soit quelque deux fois et demi le taux normal).
“L’ancienne plante consommait peu d’eau et produisait beaucoup,” se lamentait M. Laftit lors de son intervention précitée au parlement. “L’apparition d’une nouvelle plante a fait qu’aujourd’hui, pas une seule rivière ne contient de l’eau.” La nouvelle loi relative à l’usage licite du cannabis, dont c’est l’adoption qui avait motivé la présence du ministre devant les députés, doit normalement permettre de résorber au moins en partie le problème, en ce qu’un de ses arrêtés complémentaires, publié le 2 juin 2022 dans le bulletin officiel, n’autorise que les variétés dont le THC ne dépasse pas les 1%. De fait, les “khardala” et autres sont d’office écartées. Mais cette question de l’assèchement des nappes phréatiques par la faute de cultures fortement consommatrices en eaux n’est pas seulement le propre des terres cannabiques du Rif et du pré-Rif; elles concernent, en fait, tout le territoire national.
Ailleurs aussi, il devient, en effet, de plus en plus difficile pour les agriculteurs de trouver de l’eau pour pouvoir assurer les besoins de leurs plantes. Un simple chiffre peut en témoigner: révélé le 7 juillet
2022 par le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, à la chambre des conseillers, il fait état du fait qu’en deux ans seulement, le nombre de puits creusés au Maroc ait doublé, passant de 106.000 en 2020 à 258.931. Et lors de son dernier passage à la deuxième chambre, celui-là en date du 18 avril 2023, le secrétaire général du Parti de l’Istiqlal (PI) évoquait même un seuil de 372.000 puits; ce qui voudrait dire que plus de 100.000 nouveaux puits auraient, entretemps, été creusés. De toute évidence, les agriculteurs sont de plus en plus désespérés.
Certes, la sécheresse de l’année agricole en cours, une des plus chaudes de l’histoire du Maroc moderne, n’aide pas non plus. Elle s’ajoute d’autant plus à celle de l’exercice précédent, le pire même depuis l’indépendance. Par conséquent, les nappes phréatiques auraient peut-être pu mieux se porter. Mais les différents experts joints par nos soins s’accordent à dire que les choix agricoles opérés par les pouvoirs publics au cours des quinze dernières années ont indéniablement contribué à empirer les choses. En cause directement, le Plan Maroc vert (PMV).
Mise en oeuvre à partir d’avril 2008 avant que ne lui succède, pour la décennie 2020, “Génération Green”, cette stratégie sectorielle conçue sous les auspices du cabinet de consulting “McKinsey” avait vu son pilier I focaliser sur l’agriculture à forte valeur ajoutée pourvoyeuse de devises. À titre d’exemple, on peut citer la tomate, le maraîchage et les fruits rouges. Économiquement parlant, le succès a indéniablement été au rendez-vous. En dix ans, le produit intérieur brut (PIB) agricole a presque doublé. De 65 milliards de dirhams (MMDH) en 2008, il s’établissait à 125 MMDH en 2018. Même topo du côté des exportations. Dans le même laps de temps précédemment mentionné, elles ont atteint 36,3 MMDH -2,4 fois de plus qu’une décennie auparavant, où le montant ne constituait que 15,2 MMDH. Pour effet, cela a entraîné une baisse du déficit commercial à ce niveau de 7,4 MMDH.
Stratégie sectorielle
Mais tout cela à quel prix? Alors qu’il était, jusqu’à la veille de la colonisation française, un pays dont l’agriculture s’appuyait essentiellement sur la pluie, le Maroc a vu son secteur primaire mettre encore davantage le paquet sur le productivisme au détriment de ses ressources naturelles objectives. Lesquelles ne seraient pas, contrairement à une image largement relayée, celles d’un pays agricole. “C’est un mythe,” commente un des experts que nous avons consultés et qui a tenu à s’exprimer sous le sceau de l’anonymat. “Le Maroc où l’on peut faire de l’agriculture, il s’étend, grosso modo, de Tanger à Settat, et encore. Peut-être qu’il s’arrête seulement à Kénitra.”
Et notre expert de donner comme exemple la nappe phréatique du Souss, dans le Sud, où effectivement l’agriculture intensive a fait disparaître une partie du patrimoine hydrique historique de la région. Raison qui avait d’ailleurs accéléré le lancement, dès novembre 2017, des travaux de construction de la station de dessalement d’eau de mer de Chtouka-Aït. Mise en service en janvier 2022 pour un budget total de 4,41 MMDH, elle doit permettre d’irriguer une quinzaine de milliers d’hectares. Mais cette eau dessalée a un coût: environ 10 dirhams le mètre cube, contre seulement 20 centimes pour l’eau non-dessalée. “Il est clair que l’eau dessalée doit être exclusivement utilisée pour les cultures sous serre à forte valeur ajoutée, car autrement on ne gagne rien sur le plan financier,” décrypte Fouad Amraoui, professeur d’hydrologie à l’Université Hassan-II de Casablanca et auteurs de plusieurs publications sur la question de l’utilisation de l’eau dans l’agriculture nationale.

Modèle agricole national
Quand nous lui posons la question, il cite par exemple, au titre des cultures auxquelles il fait référence, les tomates cerises, les melons, les poivrons et les haricots. Mais lui aussi met en cause, dans le fond, certaines orientations prises par la politique agricole du Maroc depuis l’adoption du PMV. La pastèque à Zagora, notamment, cela aurait été une erreur, d’autant plus dans une région où les habitants peinent à trouver de quoi boire -des manifestations de la soif avaient d’ailleurs, pour rappel, eu lieu au cours de l’été 2017.
“Parfois j’ai l’impression qu’on ne coordonne pas au niveau des différents départements,” estime M. Amraoui. “Que le ministère de l’Agriculture veuille développer l’agriculture, c’est très bien. Mais il faut aussi poser la question au ministère de l’Eau pour voir si on a les ressources hydriques qu’il faut. Non seulement on ne l’a pas fait, mais on a fini par poursuivre des agendas concurrents, avec, ironiquement en plus, une subvention de l’État pour ce faire.” Naturellement, le gouvernement est bien conscient des enjeux sur la table. Une source autorisée au sein de la chefferie du gouvernement, avec qui nous avons longuement échangé, a notamment mis l’accent sur les différents projets en cours de mise en oeuvre pour soutenir le modèle agricole national. Sur le plan des ressources hydriques en elles-mêmes, outre le dessalement -une station devrait également voir le jour à Dakhla en 2025, avec comme objectif affiché d’irriguer 5.000 hectares dans la province d’Oued Ed-Dahab-, plus d’une centaine de barrages devraient incessamment voir le jour.
Parmi eux, une vingtaine d’ouvrages de grande ou moyenne taille, mais aussi 129 barrages collinaires, sur un total de 909 dont le Maroc a les capacités de se doter. En outre, l’interconnexion des différents bassins hydrauliques est également envisagée. Dès cet été 2023, celle des bassins du Sebou et du Bouregreg, le premier alimentant le second, devraient d’ailleurs être finalisée. D’un coût de 6 MMDH, le projet prévoit l’installation, sur 66,5 kilomètres, de tuyaux pour transporter de l’eau à un débit de 15 m3/seconde.
L’Exécutif compte-t-il ressortir le vieux projet de grande autoroute de l’eau, pour lequel on avait même prévu, à un moment, une enveloppe de 31 MMDH pour desservir le Sud du Maroc à partir du Nord (les cabinets d’ingénieries Novec, filiale de la Caisse de dépôt et de gestion, et Conseil-ingénierie- développement (CID) ainsi que l’Espagnol Typsa s’étaient vu confier le soin, en avril 2014, d’en faire l’étude préalable par l’Office national de l’eau et de l’électricité (ONEE))? Notre source nous a confié que la chose a été effectivement abordée au sein du comité national chargé du suivi de l’état de l’approvisionnement en eau mis en place le 30 juin 2022, mais qu’il avait finalement été décidé de prioriser pour l’instant l’interconnexion des bassins du Sebou et du Bouregreg. Enfin, pour ce qui concerne les nappes phréatiques, différents projets de recharge artificielle sont dans le pipe. Le plus emblématique d’entre eux est sans doute celui qui porte sur la nappe de Feija, qui avait vu le ministère de tutelle ainsi que la préfecture de Zagora, le conseil de la région de Draâ-Tafilalet, le conseil provincial de Zagora et les agences des bassins hydrauliques de Draâ-Oued Noun et de Guir-Ziz-Ghéris signer un accord afférent le 24 janvier 2023. Mais il en faudra certainement beaucoup d’autres. “Nous sommes malheureusement très en retard sur ce plan,” note encore M. Amraoui. “Le seul projet qui tienne vraiment la route, c’est celui de Charf El Akab, dans la région de Tanger.
Structure des prix
Pour moi, il s’agit même d’un modèle. Mais c’est bien que les choses commencent à bouger. Je pense qu’il faudra notamment développer des projets similaires au niveau du Saïss, où la nappe baisse pratiquement de 3m par an. C’est une vraie catastrophe écologique. La situation n’est pas totalement irréversible, mais il faut y aller vite.” D’autres experts croient, eux, savoir qu’au-delà des moyens mobilisés pour assurer les besoins hydriques des différents exploitations agricoles nationales, il faudra faire des choix forts et, sans doute, devoir renoncer aux cultures les plus voraces en eaux. Professeur à l’Université Sultan-Moulay-Slimane à Béni Mellal, Abdeslam Boudhar vient notamment de superviser la première véritable étude nationale portant sur l’eau virtuellement exportée dans les produits de l’agriculture marocains. À ses yeux, le Maroc ne peut, intrinsèquement, continuer d’agir comme s’il avait de l’eau à foison, et doit, au surplus, faire en sorte que ce dont il dispose se vende à son juste prix.
“Moi quand, dans un marché à Béni Mellal, j’achète de la pastèque à 40 ou 50 dirhams, cela m’arrange bien sûr, en tant que consommateur,” expose-t-il. “Mais en tant qu’expert, je sais pertinemment qu’elle m’a été vendue à un prix moindre à celui qui devrait être le sien. On ne prend pas en considération l’eau comme si elle était un bien comme les autres, c’est-à-dire un bien qui a un coût très précis. En gros, nous sommes en train de brader notre eau.” En fait, si l’eau était vraiment prise en compte dans la structure des prix des différents produits agricoles exportés, M. Boudhar croit savoir qu’il pourrait perdre, par rapport aux marchés de destination, les avantages comparatifs qui sont les siens et qui lui permettent de vendre à des prix qui défient parfois toute concurrence.
Et c’est un point qui est également mis en exergue par l’expert qui nous a indiqué qu’il ne considérait pas le Maroc comme étant un pays foncièrement agricole, en y ajoutant aussi le fait que la main d’oeuvre reste faiblement rétribuée et que si elle bénéficiait de l’indemnité qu’elle méritait, même la tomate à quinze dirhams le kilogramme paraîtrait, rétrospectivement, abordable. Lui et M. Boudhar sont par ailleurs d’avis qu’il faut mettre davantage l’accent sur des cultures comme les céréales, qui en plus de consommer moins d’eau sont également de nature à assurer la souveraineté alimentaire du Maroc. Faute d’eau en quantités suffisantes, beaucoup d’agriculteurs ont, de toute façon, dû, dans certaines régions, notamment l’embouchure de l’Oum Errabiâ, arracher leurs arbres d’eux-mêmes.
“Il y a aussi un point que l’on évoque peu, c’est que comme il faut creuser de plus en plus profondément pour trouver de l’eau, les agriculteurs les moins riches, qui n’en ont tout simplement pas les moyens, sont obligés d’abandonner,” nous déclare notre interlocuteur. “Et du coup, nous voyons une véritable violence sociale s’exercer, amenant à la concentration des terres agricoles dans les mains d’une poignée de privilégiés.” S’étant justement retrouvé, pour les raisons évoquées, dans l’obligation de renoncer à son activité d’agriculteur, le père de Rayane en sait bien quelque chose…
Toute l’actualité du Maroc dans votre boite de réception
© Maroc Hebdo. Tous les droits sont réservés