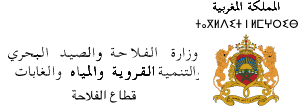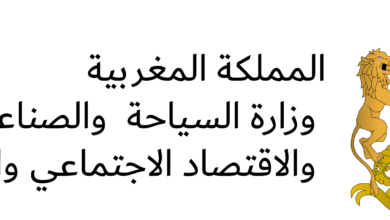Bac 2023 : le corrigé du sujet de spécialité d’Histoire Géo – Le Parisien
3eme spécialité la plus choisie parmi les lycéens de terminale : l’Histoire Géographie (HGGSP) évalue les candidats sur leurs capacités à construire une problématique et rédiger des réponses construites et argumentées face à des questions et des documents proposés. Voici le premier corrigé pour l’épreuve qui a eu lieu ce lundi 20 mars entre 14h et 18h – corrigé type par un de nos professeurs (Romain) sélectionné pour cette session 2023.
Dissertation 1 : « La production et la circulation de la connaissance connaissent-elles des frontières ? »
Le premier sujet de dissertation du jour est une grande nouveauté – accentuée par le fait que le thème sur la connaissance ne peut tomber au baccalauréat qu’une année sur deux. À ce propos, il serait intéressant que les candidats commencent par s’interroger sur le sens du terme « connaissance » : simplement, il s’agit à la fois de l’ensemble des domaines où s’exerce le savoir, ainsi que le savoir en lui-même. À ce titre, le sujet nous invite à étudier la manière dont les connaissances sont produites ainsi que les modalités de leur circulation. L’expression « société de la connaissance » (knowledge society) forgée par Peter Drucker en 1969 fait du savoir et de sa transmission un facteur de puissance économique. Ainsi, plus précisément, le sujet porte sur la puissance induite par la possession de la connaissance : dans quelle mesure la production et la circulation de la connaissance sont-elles un outil de puissance pour les différents acteurs géopolitiques ?
Ici repose l’essentiel du questionnement propre à ce sujet. En effet, la connaissance, en tant qu’enjeu majeur du monde contemporain se trouve au cœur des relations géopolitiques, mais aussi des politiques publiques et des choix économiques des différents acteurs qui la produisent. En d’autres termes, la connaissance a ses acteurs, ses flux, ses rivalités et ses conflits, qui se déclinent à toutes les échelles, à commencer à l’échelle mondiale.
Ce questionnement pourrait être développé dans un plan en trois parties, selon ce modèle :
I. La connaissance, un secret jalousement gardé par les États
II. La connaissance, objet de conflits entre acteurs
III. Vers une plus grande collaboration scientifique à l’échelle mondiale
Ainsi, dans un premier temps, les candidats chercheront à montrer que la connaissance est marquée, depuis l’Antiquité, du sceau du secret. Ce serait notamment l’occasion de travailler sur le rôle de la connaissance scientifique en tant qu’instrument de puissance au service des États, dans l’affirmation de leur puissance économique et géopolitique – et, pourquoi pas, de proposer des développements sur les services secrets. Il s’agira ici de s’intéresser aux flux et aux réseaux propres à la connaissance, ainsi qu’aux différents acteurs qui la produisent (États, entreprises de l’ « économie de la connaissance », mais aussi citoyens et individus).
En outre, en tant qu’instrument de puissance, la connaissance peut donc être à l’origine de conflits, voire de guerres. À ce titre, les différentes « courses » menées par les deux superpuissances de la guerre froide (États-Unis et URSS) en sont un bon exemple, tout comme, encore une fois, l’espionnage. La question de la possession (ou de la recherche d’acquisition) de la puissance de feu nucléaire, par différents types d’États, en est un autre.
Cet exemple permet par ailleurs de montrer que la connaissance n’est pas toujours soumise à l’arbitraire de la frontière. En d’autres termes, la coopération et la collaboration sont au cœur des modalités de production et de circulation de la connaissance, toujours plus mondialisées. Dans cette partie, les candidats pourront mettre à profit les études menées pendant l’année sur la connaissance sur la radioactivité, en particulier sur les conditions de son élaboration et de sa diffusion – jusqu’à interroger, in fine, la pertinence du modèle de « mondialisation de la connaissance ».
En conclusion, les candidats montreront ainsi que la connaissance est un instrument fondamental pour la constitution et la permanence des États, au moins depuis Sun Tzu. Outil politique, puis géopolitique, elle est devenue au fil des siècles un enjeu social et économique. Plus encore, elle est devenue un des piliers de la mondialisation, en même temps qu’elle était (et est toujours) l’un des moteurs de sa diffusion. En d’autres termes, si la production et la circulation de la connaissance connaissent de moins en moins de frontières, elles n’en restent pas moins des outils fondamentaux pour la puissance des États – comme l’indique l’empressement des Russes à récupérer le drone américain abattu en Mer Noire en mars 2023, afin de l’étudier.
Dissertation 2 : « Ruptures et continuités des formes de la guerre depuis la fin du XXe siècle »
Le second sujet de dissertation est un grand classique du programme de Terminale HGGSP, qui revient de manière assez systématique depuis l’an dernier dans les différents centres d’examen. Il s’agit finalement d’un sujet assez descriptif – mais l’on attendra des candidats qu’ils sortent précisément de cette logique descriptive afin d’approfondir une analyse du renouvellement de la conflictualité dans notre monde contemporain. À ce propos, la formulation du sujet doit alerter les candidats. En effet, la question des « ruptures » doit amener les candidats à mettre en question la pertinence du modèle clausewitzien de la guerre depuis la fin du XXe siècle. Le questionnement propre aux « continuités » laisse à penser que ce modèle connaîtrait une forme de renouveau – ici, on peut aisément penser aux formes (très) récentes de conflictualité et à leurs conséquences, notamment à travers l’exemple du conflit russo-ukrainien.
Aussi le sujet nous invite-t-il à un lourd mais précieux travail de contextualisation en introduction. Plus précisément : qu’attend-on et qu’entend-on à travers l’expression « depuis la fin du XXe siècle » ? Au prime abord, il apparaît que le choc du 11-Septembre 2001, qui a lancé la guerre d’Afghanistan (2001) puis, à rebours, celle d’Irak (2003), constitue une bascule évidente. Les candidats pourront également rappeler que l’année 2001 voit la fin des guerres de Yougoslavie, avec l’insurrection albanaise de 2001 en Macédoine (aujourd’hui Macédoine du Nord). L’année 2001 serait donc un tournant important, qui marque la fin (provisoire) des guerres sur le continent européen, qui se concentrent désormais dans un « arc de crise », lequel se caractérise par l’émergence des guerres irrégulières et de la guerre contre le terrorisme. L’étude pourrait aussi englober la dislocation de l’URSS, aube d’un monde nouveau – et « fin de l’Histoire », à l’instar de la prédiction (exagérée) de Francis Fukuyama. En d’autres termes, la bascule contextuelle serait la décennie 1991-2001, qui voit le modèle clausewitzien à la fois remis en question mais aussi réinterprété sans cesse jusqu’à aujourd’hui.
Ainsi, depuis la fin du XXe siècle, les guerres sont de moins en moins interétatiques. La guerre se transforme, et les candidats devront proposer une problématisation axée en ce sens : dans quelle mesure la guerre se transforme-t-elle depuis la fin du XXe siècle ?
Pour répondre à cette question, on pourrait une nouvelle fois envisager un plan en trois parties :
I. La guerre depuis la fin de l’URSS
II. De nouvelles manières et formes de faire la guerre : la remise en question du modèle clausewitzien
III. Vers un retour des guerres interétatiques ?
Dans un premier temps, les candidats montreront que la guerre a changé de dimension depuis la chute de l’URSS et la dislocation du bloc communiste. Beaucoup ont le sentiment, comme à l’instar de Koselleck, que l’histoire « s’accélère ».
En effet, la guerre est de plus en plus internationalisée, instantanée et s’adapte aux évolutions contemporaines, notamment à l’émergence de la mondialisation et à la diffusion toujours plus massive des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC).
Comme il faudra le montrer dans une deuxième partie, ces évolutions majeures ont une conséquence : au XXIe siècle, on ne fait plus la guerre comme auparavant.
Le modèle clausewitzien de la guerre, déjà remis en question à la fin du XXe siècle, notamment en dans le cadre de la guerre d’Afghanistan menée par l’URSS (1979-1989), n’est plus opérant.
Plus précisément, la guerre a subi d’importantes transformations.
Les candidats rappelleront que la guerre est de plus en plus irrégulière, et que les tactiques de guérilla, menées par des groupes restreints, tendent à s’imposer depuis les conflits afghan (dès 2001) et irakien (à partir de 2003). Ces guerres sont aussi de plus en plus civiles, voire visent à l’annihilation d’une partie de la population, comme le cas syrien l’illustre clairement depuis 2011.
La guerre a également tendance à devenir de plus en plus hybride, dans la mesure où elle combine des opérations conventionnelles, armées contre armées, avec des tactiques asymétriques.
Enfin, la guerre est toujours plus technologique. Il est donc attendu des candidats qu’ils mènent une analyse poussée sur la « cyberguerre » – en soi, l’exemple russe est éloquent, tant les Russes se sont fait une spécialité de la chose depuis l’Estonie (2007) et l’Ossétie du Sud (2008).
Néanmoins, les candidats pourront s’interroger sur la pertinence du modèle clausewitzien dans les conflits armés actuels. En ce sens, l’invasion de l’Ukraine par la Russie (depuis 2022) est un exemple éloquent : l’on assiste à un retour de pratiques et de techniques de combat que l’on croyait disparues, ou du moins surannées, propres à la guerre à haute intensité entre armées nationales. En outre, pour les présidents Zelensky et Poutine, « la guerre est une continuation de la politique par d’autres moyens » : lutte de défense nationale pour Zelensky, invasion-restauration impérialiste pour Poutine.
Ainsi, en conclusion, les candidats pourraient montrer que la guerre menée par la Russie contre et en Ukraine révèle à la fois les mutations récentes de la guerre, mais également ses permanences, telles que définies par Clausewitz dans De la guerre. En d’autres termes, par le renouvellement de ses modes d’action, la guerre est devenue un « fait social total » (Marcel Mauss) : depuis la fin du XXe siècle, à la conflictualité internationale (entre États) s’est substituée une conflictualité avant tout sociale (guerres civiles). Toutefois, il ne faut pas perdre de vue qu’il y a, derrière ces mutations, des permanences et des continuités fondamentales : de plus en plus, la guerre redevient « absolue », comme le montre René Girard dans Achever Clausewitz (2007).
Étude critique de documents : « En analysant les documents, en les confrontant et en vous appuyant sur vos connaissances, montrez comment la spécificité du patrimoine français est un outil au service du rayonnement de la France dans le monde. »
Le sujet d’étude critique de documents invite les candidats à s’interroger sur la puissance française, et plus spécifiquement sur le patrimoine français, perçu comme facteur de puissance. Ici, il s’agira d’évoquer le patrimoine comme outil de soft power (« puissance douce ») : en 1990, le géopolitologue américain Joseph Nye a montré que les États disposent d’une « habileté à séduire et à attirer », qu’ils cherchent à développer afin d’accroître leur influence dans le monde. Ainsi, le concept de soft power met en perspective la notion de puissance dans un cadre non conventionnel – c’est-à-dire dans un cadre qui n’est pas celui de la puissance coercitive, militaire, qualifiée de hard power.
Afin de mener ce questionnement, les candidats ont deux documents à disposition. Le premier est une photographie qui a été prise le 1er juin 1961 au château de Versailles par le photographe Cornell Capa (frère de Robert Capa, photographe mondialement célèbre). Ce document, qui se trouve aujourd’hui dans le fonds du Centre international de la photographie de New York, donne à voir le couple présidentiel français de Gaulle (Yvonne et Charles) recevoir ses homologues américains, John Fitzgerald Kennedy et Jackie Kennedy, à l’occasion d’un dîner d’État. Le second document est l’extrait d’un compte rendu de l’audition du chef étoilé français Guy Savoy, réalisé en 2008 pour le Sénat français, que l’on retrouve dans le Rapport d’information sur l’inscription de la gastronomie au patrimoine mondial de l’UNESCO rédigé au nom de la commission des Affaires culturelles du Sénat.
Combinés et croisés, ces deux documents cherchent à faire comprendre (et faire montrer !) aux candidats que la gastronomie française est, au moins depuis la guerre froide, au service du rayonnement de la France dans le monde.
Afin de montrer que la France est un État moteur en matière de « diplomatie du patrimoine », les candidats pourraient utiliser un plan suivant ce modèle :
I. D’une spécificité culturelle française …
II. … à un facteur de puissance géopolitique …
III. … reconnu internationalement
La spécificité du patrimoine culinaire français est reconnue par le Sénat, qui a interrogé le chef Guy Savoy : « cette diversité est véritablement propre à la France : le nombre de variétés de pains et de fromages en est une illustration » (doc. 2, l. 5-6). Le général de Gaulle lui-même (visible dans le doc. 1) n’aurait-il pas affirmé, par ailleurs, qu’il était difficile de « gouverner un pays où il existe 258 variétés de fromage ? » Ainsi, dans cette première partie, les candidats insisteraient sur les raisons nationales qui ont poussé la France à mener un « projet de candidature auprès de l’UNESCO » (doc. 2, l. 1) – et donc, ici, d’utiliser toutes les connaissances développées dans le cadre de l’étude menée en classe au sujet du repas gastronomique des Français, facteur de rayonnement culturel de la France dans le monde et objet d’action diplomatique.
En effet, comme nous venons de l’indiquer, la gastronomie française est perçue, à l’échelle internationale, comme un « objet d’action diplomatique ». C’est tout le sens du premier document : alors que, dans les années 1960, la France du général de Gaulle se cherche une place individuelle à l’écart des deux géants, elle utilise le savoir-faire gastronomique comme un outil diplomatique. Lorsque le couple de Gaulle reçoit les Kennedy, il ne le fait pas n’importe où : à Versailles, symbole historique de la permanence de la puissance française à travers le temps long. Dans la galerie des Glaces, plus précisément, où les convives (Jackie Kennedy a une ascendance française) (re)découvrent avec émerveillement l’art de vivre à la française et repartent avec la promesse (tenue !) d’accueillir La Joconde aux États-Unis en 1962, pour ce qui fut alors son dernier voyage hors de France.
Dès lors, il apparaît évident que la gastronomie française est au service du rayonnement de la France dans le monde. Rayonnement intellectuel, tout d’abord : « un grand nombre de chefs français sont sollicités à l’étranger et y exportent leur savoir-faire […] au Japon, […] [et] dans des pays comme la Russie, l’Ukraine ou l’Inde » (doc. 2, l. 10-14). Il s’agit aussi de rayonner sur le plan « économique et touristique » (doc. 2, l. 18-19), le poids économique de la gastronomie française représentant « l’équivalent de 180 Airbus » (doc. 2, l. 20-21). En d’autres termes, la France est une puissance gastronomique et patrimoniale mondiale, reconnue par ailleurs à l’UNESCO, comme l’indique le second document.
Ainsi, l’analyse de ces deux documents permet de montrer que le patrimoine français, notamment culinaire et gastronomique, est un outil essentiel au service du rayonnement de la France dans le monde, c’est-à-dire de son soft power. La France mène donc une politique active de « gastrodiplomatie » (Paul Rockower). Elle fut même pionnière en la matière, si bien que d’autres États cherchent aujourd’hui à l’imiter : l’un des plats préférés des Français, le couscous, n’est-il pas aussi un objet d’apaisement diplomatique entre l’Algérie, la Mauritanie, le Maroc et la Tunisie ? En tout cas, comme la pizza napolitaine, les traditions du couscous ont été inscrites sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.
Le Parisien Le Guide
Jeux Gratuits
Mots fléchés
Mots coupés
Mots croisés
Mots mêlés
Kakuro
Sudoku
Codes promo
Services
Profitez des avantages de l’offre numérique
© Le Parisien