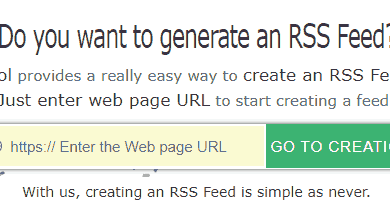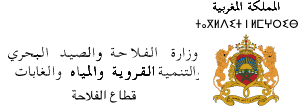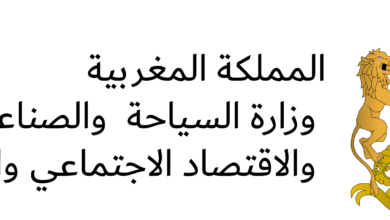Abdoulaye Sene, coordinateur du CADTM Sénégal : « À quoi a servi … – CADTM
12 septembre par Abdoulaye Sene , Robin Delobel
La population sénégalaise et sa diaspora s’interrogent sur la crise politique et la question de la démocratie au Sénégal. Vivent-elles un moment de mutation démocratique ou une crise ? De grosses incertitudes entourent les élections de février 2024 alors que Ousmane Sonko, opposant principal au gouvernement et au président Macky Sall, a suspendu sa grève de la faim, lui qui est emprisonné pour divers chefs d’inculpation dont appel à l’insurrection. Nous interrogeons Abdoulaye Sene, coordinateur du CADTM Sénégal (comité pour l’abolition des dettes illégitimes), afin de mieux saisir les enjeux politiques et économiques et aborder la question de la dette.
À l’image des économies africaines après les indépendances en 1960, l’économie du Sénégal peut être caractérisée comme étant très fragile malgré les satisfécits des institutions financières internationales. En effet, à suivre ce qui se dit sur le Programme Sénégal Émergent (PSE) on serait tenté de croire avec les taux de croissance projetés à deux chiffres – malgré les difficultés liées au COVID – et ceux enregistrés ces dernières années entre 5 et 7% que le Sénégal est sur la voie de « l’émergence ». Cependant l’examen des statistiques et des faits économiques montre tout le contraire. L’indice de développement humain est très faible avec un niveau de 0, 511 (chiffres de 2021). La prépondérance du secteur informel qui contribue pour 41,6 % au PIB PIB
Produit intérieur brut Le PIB traduit la richesse totale produite sur un territoire donné, estimée par la somme des valeurs ajoutées.
Le Produit intérieur brut est un agrégat économique qui mesure la production totale sur un territoire donné, estimée par la somme des valeurs ajoutées. Cette mesure est notoirement incomplète ; elle ne tient pas compte, par exemple, de toutes les activités qui ne font pas l’objet d’un échange marchand. On appelle croissance économique la variation du PIB d’une période à l’autre. et reste le plus grand pourvoyeur d’emplois ( 9 emplois sur 10 sont dans le secteur informel- RGE [1], la faible productivité et la fragilité de l’économie devant les chocs exogènes constituent les principales caractéristiques de cette économie.
Le Sénégal avec ses 700 kilomètres de côte est ouvert sur l’océan atlantique et l’océan pacifique, dispose de ressources halieutiques malheureusement bradées du fait des accords signés avec l’Union Européenne mais aussi à travers l’octroi de licences de pêche aux Chinois et à d’autres navires étrangers. Ainsi, le déclin de la pêche artisanale constitue un des déterminants de l’immigration irrégulière via les petits bateaux de fortune. De même, le pays en dehors de ses réserves de phosphates, qui au moins sont transformés sur place en très grande partie, dispose de zircon dont l’exploitation ne profite pas aux populations qui vivent dans la contrée des exploitations de ce minerai. Par ailleurs, ce sont des sociétés canadiennes qui opèrent dans les plus grandes mines Endeavour et l’exploitation des mines d’or dans les zones frontalières du Mali à Kédougou au Nord Est du pays (à 700 km de Dakar), malgré les chiffres d’affaires annoncés par les sociétés détentrices de titre d’exploitation (Irlandaise – Sud Africaine à travers des sociétés qui opèrent sous des filiales de droit sénégalais), n’impacte pas positivement la vie des populations de cette partie du pays qui reste l’une des régions avec le plus de pauvres selon des études récentes (ANSD, 2021). [2] Il y a des attentes avec les découvertes de pétrole et de gaz offshore mais si la gouvernance ne change pas l’impact risque d’être aussi inexistant pour les populations. A moins que ces dernières ne se mobilisent pour exiger plus de transparence dans la gestion des contrats et des produits.
Dans les premières années après les indépendances octroyées, le Sénégal avait entrepris un processus d’industrialisation de substitution des importations et une présence de l’État dans plusieurs secteurs : mines, énergie, agriculture, pêche, huileries, transport et services. Avec la crise de la dette à la fin des années 1970 début 1980, l’avènement des politiques d’ajustement structurel a amené nos pays à se désengager grandement de tous les secteurs suivant en cela la bible de la Banque mondiale Banque mondiale
BM La Banque mondiale regroupe deux organisations, la BIRD (Banque internationale pour la reconstruction et le développement) et l’AID (Association internationale de développement). La Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) a été créée en juillet 1944 à Bretton Woods (États-Unis), à l’initiative de 45 pays réunis pour la première Conférence monétaire et financière des Nations unies.
En 2022, 189 pays en sont membres.
Cliquez pour plus de détails. et du FMI FMI
Fonds monétaire international Le FMI a été créé en 1944 à Bretton Woods (avec la Banque mondiale, son institution jumelle). Son but était de stabiliser le système financier international en réglementant la circulation des capitaux.
À ce jour, 190 pays en sont membres (les mêmes qu’à la Banque mondiale).
Cliquez pour plus de détails. consistant en moins d’État et toujours plus de dérégulation.
Non seulement les dettes transférées aux États « indépendants » par le colonisateur, alors qu’elles ont été contractées pour les intérêts de la puissance dominante, sont illégitimes et odieuses mais on pourrait valablement caractériser les dettes contractées durant les périodes de l’ajustement structurel comme illégitimes. On a forcé nos pays à s’endetter pour rembourser les prêts consentis. Il faut préciser aussi que les élites politiques après les indépendances ont détourné une part de cet argent et l’ont replacé dans des banques occidentales, les créanciers le savaient.
Cette mise en œuvre des PAS à débouché sur l’informalisation de l’économie, l’absence d’investissements dans les secteurs sociaux ( santé – éducation – accès à l’eau et à l’assainissement) au profit du remboursement de la dette Dette Dette multilatérale : Dette qui est due à la Banque mondiale, au FMI, aux banques de développement régionales comme la Banque africaine de développement, et à d’autres institutions multilatérales comme le Fonds européen de développement.
Dette privée : Emprunts contractés par des emprunteurs privés quel que soit le prêteur.
Dette publique : Ensemble des emprunts contractés par des emprunteurs publics. . Il y a eu des milliers de pertes d’emplois, une baisse des taux de scolarisation, un accès difficile à des soins de santé corrects et tout ceci accompagné de privatisations des secteurs rentables ( télécoms – eau – mines etc.). L’impasse de ces politiques a généré les stratégies de réduction de la pauvreté, les programmes d’allégement des dettes avec l’initiative PPTE PPTE
Pays pauvres très endettés L’initiative PPTE, mise en place en 1996 et renforcée en septembre 1999, est destinée à alléger la dette des pays très pauvres et très endettés, avec le modeste objectif de la rendre juste soutenable.
Elle se déroule en plusieurs étapes particulièrement exigeantes et complexes.
Tout d’abord, le pays doit mener pendant trois ans des politiques économiques approuvées par le FMI et la Banque mondiale, sous forme de programmes d’ajustement structurel. Il continue alors à recevoir l’aide classique de tous les bailleurs de fonds concernés. Pendant ce temps, il doit adopter un document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP), parfois juste sous une forme intérimaire. À la fin de ces trois années, arrive le point de décision : le FMI analyse le caractère soutenable ou non de l’endettement du pays candidat. Si la valeur nette du ratio stock de la dette extérieure / exportations est supérieure à 150 % après application des mécanismes traditionnels d’allégement de la dette, le pays peut être déclaré éligible. Cependant, les pays à niveau d’exportations élevé (ratio exportations/PIB supérieur à 30 %) sont pénalisés par le choix de ce critère, et on privilégie alors leurs recettes budgétaires plutôt que leurs exportations. Donc si leur endettement est manifestement très élevé malgré un bon recouvrement de l’impôt (recettes budgétaires supérieures à 15 % du PIB, afin d’éviter tout laxisme dans ce domaine), l’objectif retenu est un ratio valeur nette du stock de la dette / recettes budgétaires supérieur à 250 %. Si le pays est déclaré admissible, il bénéficie de premiers allégements de son service de la dette et doit poursuivre avec les politiques agréées par le FMI et la Banque mondiale. La durée de cette période varie entre un et trois ans, selon la vitesse de mise en œuvre des réformes clés convenues au point de décision. À l’issue, arrive le point d’achèvement. L’allégement de la dette devient alors acquis pour le pays.
Le coût de cette initiative est estimé par le FMI en 2019 à 76,2 milliards de dollars, soit environ 2,54 % de la dette extérieure publique du Tiers Monde actuelle. Les PPTE sont au nombre de 39 seulement, dont 33 en Afrique subsaharienne, auxquels il convient d’ajouter l’Afghanistan, la Bolivie, le Guyana, Haïti, le Honduras et le Nicaragua. Au 31 mars 2006, 29 pays avaient atteint le point de décision, et seulement 18 étaient parvenus au point d’achèvement. Au 30 juin 2020, 36 pays ont atteint le point d’achèvement. La Somalie a atteint le point de décision en 2020. L’Érythrée et le Soudan n’ont pas encore atteint le point de décision.
Alors qu’elle devait régler définitivement le problème de la dette de ces 39 pays, cette initiative a tourné au fiasco : leur dette extérieure publique est passée de 126 à 133 milliards de dollars, soit une augmentation de 5,5 % entre 1996 et 2003.
Devant ce constat, le sommet du G8 de 2005 a décidé un allégement supplémentaire, appelée IADM (Initiative d’allégement de la dette multilatérale), concernant une partie de la dette multilatérale des pays parvenus au point de décision, c’est-à-dire des pays ayant soumis leur économie aux volontés des créanciers. Les 43,3 milliards de dollars annulés via l’IADM pèsent bien peu au regard de la dette extérieure publique de 209,8 milliards de dollars ces 39 pays au 31 décembre 2018. . Tout en maintenant dans le contenu les mêmes politiques, des nouveaux concepts sont mis en avant pour cacher et légitimer les politiques de domination des pays africains dits en développement, moins avancés etc. Ainsi, l’initiative d’allégement destiné aux « Pays Pauvres Très Endettés » (PPTE) dans les années 2000, était conçue de sorte que les allégements de la dette ne concernaient que les pays ayant atteint le point d’achèvement. Cela signifie un niveau de soutenabilité de la dette qui rend le pays éligible à l’initiative. En réalité, c’était une forme d’escroquerie, de nouveaux concepts étaient inventés à chaque fois pour remplacer les PAS, et pour y être éligible. C’était la croix et la bannière et les résultats furent finalement plus d’endettement et plus de pauvreté. La dépendance de nos économies par rapport aux institutions financières internationales, qui détruisent et ensuite recommandent d’introduire une dimension sociale dans l’ajustement, appauvrit plutôt qu’elle ne crée des économies fortes et capables de construire le bien être pour les populations.
Ainsi, après les différentes impasses traversées, nous peinons à atteindre les OMD (objectifs millénaires du développement 2015) encore moins les ODD (objectifs de développement durable pour 2030), ce qui fait que l’on parle de programmes stratégiques pour l’émergence depuis 2014 chez nous.
Répondant à une question sur le PSE, Amadou Aly Mbaye qui était Directeur de centre de Recherches pour l’Économie Appliquée ( CREA) disait en 2016 ( Nouvel Hebdo – Avril 2016) que les secteurs qui survivent dans ce pays ce sont ceux qui sont adossés à des positions de rente, comme les télécoms, les banques, les mines etc. Selon lui une position de rente est une position octroyée dans un monopole de droit avec l’octroi d’une licence ( Orange ), le sucre avec Mimrarn ( la seule industrie du sucre au Sénégal à Richard Toll 250 km de Dakar, qui bénéficie du monopole octroyé par l’État depuis la fin des années 70. A la question qu’est-ce qu’une position de rente il disait : « La rente, c’est une position de privilège qui procure des avantages qui ne sont justifiés ni par le niveau des risques qu’on prend, ni par les efforts fournis. Par exemple, vous voulez entrer dans le secteur des télécoms, l’acquisition d’une licence vous donne une telle position, c’est-à-dire la possibilité d’exploiter une situation de monopole de droit et de réaliser un niveau de profit supérieur à ce que le marché aurait permis. Vous voulez entrer dans le secteur bancaire ou financier, le dispositif institutionnel en vigueur vous permet de le faire et d’accéder à un secteur protégé et qui procure des avantages. » La situation n’a pas beaucoup changé.
Nous pouvons répondre à votre question de l’emprise importante des industries françaises dans l’économie en partant de cette assertion. En effet, il y a Orange ( France Telecom à l’époque a été déclarée adjudicatrice de la SONATEL pour 50 milliards en 1987) mais aussi l’exploitation de l’eau cédée en 2020 malgré toutes les vices relevées dans l’appel d’offres à SUEZ. Une filiale de Bouygues, la SAUR,avait bénéficié pendant 15 ans d’un contrat d’affermage dans le secteur. L’exploitation du TER a été confiée à une filiale de la SNCF. Absent lors des appels d’offres pour l’exploitation d’une bonne partie des gisements de gaz et de pétrole Total Énergies s’est vu octroyer un large champ à explorer de façon léonine et cela a causé la démission du ministre de l’énergie de l’époque qui s’y était farouchement opposé. De même, le secteur bancaire a été longtemps dominé par les filiales des banques françaises : BNP – Paribas – SGBS (Société Générale des Banques au Sénégal). Cependant, aujourd’hui si il y a diversification des partenaires – les Émiratis sont au port, les Turcs dans l’exploitation de l’aéroport, l’influence française reste forte avec la zone CFA qui empêche les pays de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine, l’UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine) de disposer d’une politique monétaire efficiente.
Prise dans son ensemble, l’économie du Sénégal est essentiellement informelle, fragile et la mainmise de la France dans l’économie est réelle mais nous pensons qu’un pays comme la Cote d’Ivoire connaît une mainmise plus importante encore de la France.
Il y a un net recul de la démocratie et une utilisation de la justice à des fins politiques pour empêcher un parti et son leader Ousmane Sonko de participer librement aux élections à venir. En effet, après la condamnation à deux ans de prison ferme pour « corruption de jeunesse » suite à un procès par contumace, il a été arrêté le 31 juillet 2023 pour vol de portable et finalement pour appel à l’insurrection et d’autres crimes pour lesquels les 1060 prévenus de ce parti en prison sont aussi poursuivis. Cela signifie que ces emprisonnements tout azimut contre les militants et sympathisants de ce parti ne peuvent pas être pris sérieusement pour ce qui est déclaré officiellement. Alors qu’au même moment plus de soixante jeunes ont été tués dans des manifestations de 2021 à aujourd’hui sans aucune enquête sérieuse ne soit ouverte, des membres du parti au pouvoir s‘autorisent toutes formes de déclarations et même des appels au meurtre sans aucune suite.
Ainsi, nous estimons que l’emprisonnement de Ousmane Sonko est plus la suite de la persécution de l’opposant qu’il est et non autre chose. Le fait de l’avoir séquestré pendant 55 jours chez lui, sans aucune base légale avant de l’arrêter en est la parfaite illustration. La dissolution de son parti, alors qu’aucun des faits pour lesquels ses membres sont poursuivis ne sont encore jugés, nous ramène 60 ans derrière et pose aussi un problème de droit. Finalement, ce à quoi on assiste aujourd’hui c’est l’avènement d’une dictature qui veut contrôler les libertés d’association et de d’expression en utilisant la violence « légitime de l’État ». Si c’est Ousmane Sonko et le PASTEF qui sont concernés aujourd’hui, demain qui d’autre ?
L’actuel président a déclaré renoncer à briguer un troisième mandat, à la suite des mobilisations internes et des pressions demandant de réaliser les conditions d’élections libres, transparentes et inclusives et libérer tous les détenus d’opinion qui croupissent dans ses geôles. Un retour à la démocratie est ce à quoi aspirent les Sénégalais dans leur écrasante majorité et des enquêtes sérieuses doivent être entreprises sur tous ces morts durant les manifestations de 2021 à nos jours.
Ce sont ceux qui le persécutent qui peuvent répondre à cette question. Cependant, pour un observateur ce qui est clair et factuel, c’est que le président actuel et ses partisans le perçoivent comme quelqu’un qui pourrait probablement s’insurger contre les privilèges qu’ils détiennent. Ce qui expliquerait qu’ils ne veulent pas qu’il soit un candidat aux prochaines élections. Sonko se définit comme un anti système ce qui n’arrange pas la classe politique en place depuis les indépendances.
Nous pensons quant à nous ( pas du point de vue du CADTM, mais nous, comme singularité), que Sonko est le catalyseur d’un ras de bol généralisé des jeunes du pays et de l’Afrique et qu’il suscite de l’espoir auprès de ces derniers. Cet espoir, c’est un fort désir d’indépendance et de liberté contre les impérialistes qui depuis les « indépendances », nous imposent leur vision du développement. Cet espoir c’est la fin de la corruption, d’une gestion beaucoup plus transparente des ressources et la fin de l’impunité des prédateurs, c’est une redistribution plus égalitaire, plus équitable des richesses. Cela signifie aussi, un accès aux services de base, éducation de qualité, une santé pour tous, etc. Cela va au-delà de la figure messianique de Sonko. Mais une question fondamentale se pose, quelle est l’alternative qu’il propose en termes de choix de développement, en termes de réformes institutionnelles (indépendance de la justice, décentralisation réelle du pouvoir), en termes de mécanismes de contrôle des politiques publiques par les masses ? En effet, il ne suffit pas de redéfinir les relations avec les Partenaires Techniques et Financiers qu’on appelle PTF, en d’autres termes les bailleurs de fonds, ce qui est fondamentalement important mais ne saurait constituer le seul pas à franchir pour un meilleur bien être des populations. La crise politique n’a laissé personne indifférente, les intellectuels en masse s’interrogent sur le devenir du pays, mettent en branle des pensées sur le vivre ensemble tout en exigeant le retour à la démocratie, l’inclusion de tous dans le jeu électoral. C’est dire que nous sommes à un moment crucial dans la construction de notre pays. La réflexion doit être de mise de même que l’exigence démocratique.
La dette publique du Sénégal s’élève à 13 230, 6 milliards de francs CFA en juin 2022 soit 76, 62 % du PIB selon la Direction générale de la Comptabilité Publique et du Trésor – Direction de la dette publique (Bulletin Statistique de la Dette publique trimestre 4, 2022). Il convient de noter que le stock de la dette Stock de la dette Montant total des dettes. à cette date constitue l’encours de la dette le plus élevé depuis les indépendances. Le service de la dette Service de la dette Remboursements des intérêts et du capital emprunté. est passé de 1,78 mds USD à 1, 75 mds USD, au moment où le budget de l’État culmine à environ 4245 milliards de francs CFA soit 6,99 mds USD. Cela signifie que le quart du budget est consacré au paiement de la dette. Avant d’en venir à la structure de cette dette, si nous jetons un regard rétrospectif sur l’endettement, l’on se rend compte que parmi les gouvernements qui se sont succédé, celui de Macky Sall est celui qui s’est le plus endetté pour des résultats très mitigés. L’indice de développement humain du Sénégal était de 0,490 durant la dernière année de Wade ( 2011) alors qu’avec l’avènement de Macky Sall on fait face à un surendettement record (13230,6 milliards de frs CFA) de 76,62% du PIB, et le pays est classé à la 170e place pour un IDH Indicateur de développement humain
IDH Cet outil de mesure, utilisé par les Nations unies pour estimer le degré de développement d’un pays, prend en compte le revenu par habitant, le degré d’éducation et l’espérance de vie moyenne de sa population. de 0,511. Nous sommes à peine sortis des pays à faible IDH < 0, 507 ( countryeconomy.com) et le Sénégal est en dessus de la moyenne en Afrique au sud du Sahara qui est de 0, 541.
Le PIB nominal en 2022 est 25, 37 mds USD – 17270 milliards de francs CFA, contre 15, 36 mds USD en 2012. Cela signifie qu’il y eu plus de croissance en valeur absolue avec Macky Sall qu’avec Wade mais cela ne s’est pas traduit par une amélioration des conditions de vie des populations. Cette croissance est au bénéfice de multinationales qui rapatrient leurs bénéfices dans leurs pays d’origine. L’exemple d’Orange Sénégal est assez illustratif de cette situation. Quand Orange réalise un chiffre d’affaires de plus de 1000 milliards avec le groupe SONATEL, une bonne partie de la plus-value Plus-value La plus-value est la différence entre la valeur nouvellement produite par la force de travail et la valeur propre de cette force de travail, c’est-à-dire la différence entre la valeur nouvellement produite par le travailleur ou la travailleuse et les coûts de reproduction de la force de travail.
La plus-value, c’est-à-dire la somme totale des revenus de la classe possédante (profits + intérêts + rente foncière) est donc une déduction (un résidu) du produit social, une fois assurée la reproduction de la force de travail, une fois couverts ses frais d’entretien. Elle n’est donc rien d’autre que la forme monétaire du surproduit social, qui constitue la part des classes possédantes dans la répartition du produit social de toute société de classe : les revenus des maîtres d’esclaves dans une société esclavagiste ; la rente foncière féodale dans une société féodale ; le tribut dans le mode de production tributaire, etc.
Le salarié et la salariée, le prolétaire et la prolétaire, ne vendent pas « du travail », mais leur force de travail, leur capacité de production. C’est cette force de travail que la société bourgeoise transforme en marchandise. Elle a donc sa valeur propre, donnée objective comme la valeur de toute autre marchandise : ses propres coûts de production, ses propres frais de reproduction. Comme toute marchandise, elle a une utilité (valeur d’usage) pour son acheteur, utilité qui est la pré-condition de sa vente, mais qui ne détermine point le prix (la valeur) de la marchandise vendue.
Or l’utilité, la valeur d’usage, de la force de travail pour son acheteur, le capitaliste, c’est justement celle de produire de la valeur, puisque, par définition, tout travail en société marchande ajoute de la valeur à la valeur des machines et des matières premières auxquelles il s’applique. Tout salarié produit donc de la « valeur ajoutée ». Mais comme le capitaliste paye un salaire à l’ouvrier et à l’ouvrière – le salaire qui représente le coût de reproduction de la force de travail -, il n’achètera cette force de travail que si « la valeur ajoutée » par l’ouvrier ou l’ouvrière dépasse la valeur de la force de travail elle-même. Cette fraction de la valeur nouvellement produite par le salarié, Marx l’appelle plus-value.
La découverte de la plus-value comme catégorie fondamentale de la société bourgeoise et de son mode de production, ainsi que l’explication de sa nature (résultat du surtravail, du travail non compensé, non rémunéré, fourni par le salarié) et de ses origines (obligation économique pour le ou la prolétaire de vendre sa force de travail comme marchandise au capitaliste) représente l’apport principal de Marx à la science économique et aux sciences sociales en général. Mais elle constitue elle-même l’application de la théorie perfectionnée de la valeur-travail d’Adam Smith et de David Ricardo au cas spécifique d’une marchandise particulière, la force de travail (Mandel, 1986, p. 14). est rapatriée en France à travers des mécanismes bien rodés ( approvisionnements – frais de gestion – salaires expatriés – études etc..) .
Durant le COVID, les facilités d’endettement et les rééchelonnements ont permis à l’État de mettre un appui budgétaire de 1000 milliards pour faire face aux contraintes entrainées par la pandémie. Il s’agissait d’assister les populations les plus démunies du fait des pertes de revenus durant cette période, d’améliorer et de renforcer les capacités de résilience du système de santé, d’appuyer les entreprises impactées négativement par la pandémie, etc. Cependant, l’évaluation de la mise en œuvre des dépenses au sein des institutions par la cour des comptes a établi dans un rapport rendu public des détournements d’objectifs, des enrichissements sans causes qui doivent faire l’objet de poursuites au niveau des juridictions du pays. Par ailleurs, les grands projets du président Macky Sall, comme le TER qui ont été très budgétivores en termes de financements ( 1000 milliards pour la première phase du projet) ne sont pas des modèles de gouvernance comparés aux coûts de projets analogues au Maroc et dans d’autres pays. L’impact de ce surendettement au total n’est pas ressenti positivement au niveau du quotidien des populations. C’est ainsi que plus de 700 milliards de frs CFA ont été consacrés à des solutions pour amoindrir les inondations dans le pays mais beaucoup de familles ne sont pas tranquilles à l’orée de la saison des pluies. En effet, des populations des quartiers périphériques à Dakar ( comme à Keur Massar) ou dans les régions de l’intérieur ( Touba ) restent dans les eaux dès le démarrage de la saison des pluies malgré les investissements invoqués. Au même moment, les classes dirigeantes parasitaires semblent s’enrichir chaque jour au vu de leurs manières de vivre. Le PSE, plan stratégique pour l’émergence, avait été lancé en grande pompe mais n’est pas l’objet d’une évaluation critique publique permettant de voir ce qui s’est réellement passé.
En effet, avec Wade le service de la dette était plafonné à environ 400 millions de dollars US en 2011, et le stock de la dette à 36% du PIB, il est aujourd’hui de 76, 6%, cela montre que l’endettement a été exponentiel entre 2015 et 2022. La question qui se pose est : à quoi ça a servi ? Je le répète, l’évolution de l’ indice de développement humain du Sénégal ne montre pas un impact positif de ce surendettement sur le vécu des populations. Les inondations auxquelles sont confrontées les populations durant les hivernages illustrent que les travaux d’infrastructures pour améliorer les conditions d’hygiène et d’assainissement dans les banlieues ne sont pas à la hauteur des attentes des populations. Par ailleurs, le chômage endémique des jeunes explique le rush de ces derniers vers l’immigration clandestine mortifère. De même, l’accès à des soins de santé de qualité est rare et cher ce qui fait que les populations sont encore dans l’automédication et le recours aux médicaments frauduleux contrefaits.
Les routes, les autoroutes à péages, les aéroports, le TER, les BRT ( Bus Rapid Transit ) sont des réalisations phares du gouvernement de Macky Sall ont apparemment amélioré les déplacements des populations, mais à des coûts faramineux et sont gérés par des sociétés d’exploitation souvent étrangères. Les coûts environnementaux et sociaux de ces infrastructures ne sont pas généralement pas pris en compte, ce qui fait qu’il y a encore des populations impactées qui mènent des luttes pour une meilleure indemnisation.
Ainsi, un examen approfondi de la structure de la dette s’impose à travers un audit citoyen de la dette à l’effet de déterminer les usages de l’argent emprunté , les résultats obtenus et les amortissements auxquels les générations devront faire face, alors qu’ils n’ont pas été consultés au moment des emprunts.
On ne peut pas parler des populations en généralisant. Il y a ceux qui sont avec l’opposition et une bonne partie de la société civile y compris les intellectuels (professeurs d’universités, avocats etc.) qui sont pour une restauration de la démocratie, la libération des prisonniers politiques d’une part. D’autre part, il y a les populations encore fidèles au camp du président, qui défendent que la démocratie est toujours de mise et que l’État doit être ferme contre les « terroristes ».
Ainsi, le pays est bipolarisé autour de cette crise dont les enjeux sont les élections de février 2024. Si, la partie qui se joue via les réseaux sociaux semble bénéfique aux opposants, ce qui explique que l’État a tendance à couper partiellement l’internet (deux fois cette année ) pour limiter les communications au sein des jeunes, personne ne peut préjuger de ce qui peut advenir. Le Front – 2024 ( F24), rassemblement des opposants contre un troisième mandat en 2024 du président qui finalement s’est déclaré non partant, revendique aujourd’hui la libération de Sonko qui fait une grève de la faim et tous ceux qui sont arrêtés pour ces motifs (appel à l’insurrection, troubles de l’ordre public, actes de nature à mettre en danger la sécurité de l’État ) et l’organisation d’élections libres et inclusives. Ce front va appeler à des manifestations au courant du mois de septembre même si jusqu’à présent toutes les demandes sont systématiquement refusées par le préfet. Il convient de souligner que les déclarations et les pétitions initiées par des intellectuels pour exiger le retour à une démocratie réelle dans le pays, la libération de Sonko et des autres détenus politiques, font feu de tout bois.
Au niveau du camp du président qui n’est en théorie plus candidat à sa propre succession à la suite de la forte mobilisation contre le troisième mandat, il est question de trouver un candidat pour la coalition « Benno » ce qui semble poser un problème du fait de la diversité des candidats à la candidature. Le pays traverse pour ainsi dire une situation très incertaine et le dialogue, initié par le président avec une partie de la classe politique, qui a redonné à Karim Wade et Khalifa Sall le droit d’être élus, n’y a pas changé grand-chose. C’est dire que personne ne pourrait présumer de ce qui peut se passer d’ici les élections de février 2024.
[1] RGE recensement général des entreprises au Sénégal réalisé en 2016
[2] Rapport Final, Enquête harmonisé sur les conditions de vie des ménages (EHCVM) au Sénégal , en 2018-2019- 2021
16 décembre 2013, par Abdoulaye Sene
Interview d’Abdulaye Sene par Olivier Bonfond – Dakar Novembre 2009
8 décembre 2009, par Abdoulaye Sene
CADTM Belgique
9 juin, par Sushovan Dhar , Robin Delobel
24 mars, par Robin Delobel
France
10 mars, par Robin Delobel
6 mars, par Robin Delobel , Yiorgos Vassalos
7 décembre 2022, par Sushovan Dhar , Robin Delobel
18 novembre 2022, par Sushovan Dhar , Robin Delobel
15 octobre 2022, par Robin Delobel , Michael Roberts
5 octobre 2022, par Maria Elena Saludas , Robin Delobel
14 juin 2021, par Robin Delobel , Richecarde Célestin
14 janvier 2021, par Robin Delobel , Milan Rivié , Anaïs Carton
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60
CADTM
COMITE POUR L’ABOLITION DES DETTES ILLÉGITIMES
8 rue Jonfosse
4000 – Liège- Belgique
00324 60 97 96 80
info@cadtm.org
Bulletin électronique
À propos du CADTM
Que fait le CADTM ?