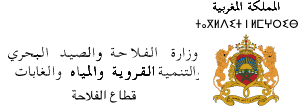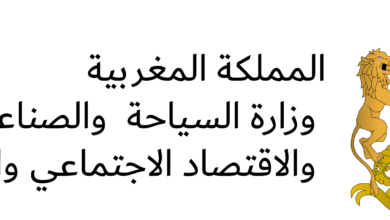Abdeljalil Bouzouggar: 'La société sédentaire la plus ancienne dans … – Maroc Hebdo
En continu
Tragédie d’Al-Haouz : Sur le dos des victimes, le nouveau c…
Tragédie d’Al-Haouz : Pour Akhannouch, la priorité sera …
Témoignages. Florian, touriste arrivé juste avant le séis…
Séisme au Maroc : le bilan s’alourdit à 2681 morts et 2501…
Tragédie d’Al-Haouz : La liste non exhaustive des événeme…
Nommé il y a une année jour pour jour à la tête de l’Institut national des sciences de l’archéologie et du patrimoine, Abdeljalil Bouzouggar fait le point sur les dernières découvertes au Maroc. Surtout, il pointe du doigt les idées reçues sur l’histoire antéislamiques du Maroc et déconstruit les mythes d’une “civilisation importée”.
Souvent, on pense qu’avant l’arrivée des Ommeyades et de l’islam, le Maroc était une région peu influencée par la civilisation antique. Est-ce vrai ?
Je le dis sans hésitation, c’est une erreur. Il faut en fait arrêter de parler de “période romaine”, mais plutôt de période “maurétano- romaine”. Quand les romains sont arrivés, avec leur urbanisme, leur tradition juridique etc…Mais ils n’ont pas trouvé un territoire vide. Il y avait des royaumes amazighs. Et qui dit royaume, dit organisation sociale, politique, religieuse, économique… Il y avait même des monnaies qui étaient frappés, ce qui veut dire qu’il y avait non seulement une structure complexe et hiérarchisée mais également des échanges avec d’autres peuples ou peuplades.
Ce substrat était très solide. Un substrat qui existait déjà avant notamment durant la période phénicienne, mais l’intérieur du pays n’a pas réellement été influencé par les vagues de population originaires du croissant fertile qui étaient principalement intéressées par les comptoirs portuaires et commerciaux. Il y avait certes des contacts avec les populations locales mais leur influence était limitée. Leur présence n’a pas influencé la composante biologique de la population par exemple, ni introduit la culture agro-pastorale.
Donc il y avait une société sédentaire au Maroc avant celle du croissant fertile ?
Au Maroc, et c’est très peu connu, il y a l’une des sociétés sédentaires les plus anciennes du monde, si ce n’est la plus ancienne, 15.000 avant notre ère. Depuis tous petits on nous a appris que la civilisation venait d’Orient, ce qui est évidemment faux. Avec les découvertes archéologiques nouvelles, surtout depuis 2014, on est dans un tout nouveau paradigme. Je vous donne l’exemple de la carie dentaire découvertes dans les sépultures du paléolithique découvertes dans les grottes du Pigeon à Tafouralt. On a trouvé des traces de gland du chêne séchées et transformés en poudre ou en farine.
En archéologie, la présence de caries dentaires est synonyme de populations qui se sont fixées dans un endroit. C’est-à-dire que cette population stockait ses aliments. Et pour l’instant c’est les populations sédentaires les plus anciennes que l’on a trouvé dans le monde. Certes, pour définir la sédentarisation, on a la céréaliculture, la poterie, la domestication des animaux…Etc. Mais il s’agit là du produit final, fruit d’un processus qui a commencé plusieurs milliers d’années avant.
Dans le paléolithique supérieur au Maroc, on trouve déjà des traces de semi-domestication du mouflon à manchette, car il constituait près 80% de la consommation de viande à l’époque. Rappelons que cette espèce très topographique a comme élément de prédilection les massifs rocheux. Si c’était encore une société de chasseurs-cueilleurs, on doit trouver normalement dans les sépultures des traces de fractures. Pourtant l’on est dans un massif. Dans le mésolithique européen (6400 avant notre ère) par exemple, on trouve des corps jonchés de traces de blessures osseuses. Celà veut simplement dire que l’on est dans société très évolués par rapport à ce que l’on croyait jusqu’à il y a très peu.
Autre que la capacité de stockage et de contrôle des espèces animales environnantes, quels autres éléments prouvent le sédentarisme de la société marocaine ancestrale ?
Les inhumations. On trouve par exemple une nécropole de plus de 200 squelettes dans les seules grottes du pigeon. Ce n’est pas là le fait d’une société nomade, bien au contraire. Certains squelettes étaient enterrés avec plus de soins et de visibilité que d’autres, donc on parle en plus de celà de sociétés hiérarchisées avec une organisation sociale très complexe. Il y a également, et c’est une découverte récente, la plus ancienne trace de trépanation dans le monde, qui est une opération chirurgicale qui consiste à percer le crâne pour soulager certaines douleurs. Elle est datée de 15.000 ans. Ce qu’il faut en retenir c’est que la personne soumise à cette pratique fait une confiance aveugle à son auteur, un peu comme la confiance qu’a le patient actuel envers son médecin, ce qui veut dire qu’il y avait une sorte de “caste de guérisseurs” à cette époque. Et la seconde chose, c’est qu’il y a une connaissance approfondie de la population de la flore qui l’entoure car il s’agissait d’une opération extrêmement douloureuse, donc des éléments “anesthésiants” étaient utilisés. En somme, nous pouvons dire que le Maroc est l’un des berceaux de la société agricole et sédentaire, donc de la civilisation moderne.
Pour le développement des recherches, où en est-on?
Ce que l’on vit aujourd’hui est un tournant, je n’ai jamais vu de mon vivant un aussi grand engouement au niveau politique pour le travail archéologique. Les moyens qui sont mis sont colossaux, nous avons aujourd’hui tous les appuis financiers et logistiques qui nous permettent de faire un véritable travail en archéologie. Nous sommes également en pleine rénovation de l’institut avec des laboratoires de dernière génération en termes technologiques. C’est ce qui nous permet aujourd’hui de faire des découvertes de manière aussi approfondies et de démultiplier les efforts.
Comment forme-t-on les archéologues marocains ?
Ce secteur connaît une évolution remarquable et inédite, qui est cependant imputable à la profonde profondeur historique. Ce que l’on voit comme réalisation et comme découvertes aujourd’hui est le résultat d’un parcours qui a commencé en 1985, et la création de l’INSAP. Avant celà, il y avait bien évidemment des archéologues marocains qui ont grandement contribué à l’émergence de cette discipline, comme Joudia Hassar Benslimane qui était la première directrice de l’INSAP et qui a fait un travail exceptionnel, mais ils étaient formés à l’étranger. Depuis, on a commencé à former localement des jeunes archéologues marocains. Ce système a connu plusieurs réformes. De 1985 jusqu’en 2012, on était dans un système de bac+4. Après, on a intégré le système Licence-Master-Doctorat. A partir de 2016, on a commencé à former les premiers docteurs en archéologie 100% marocains.
Les bacheliers marocains s’intéressent- ils à cette filière ?
Cette année par exemple, sur la plateforme d’organisation du concours qui aura lieu ce 22 juillet 2023, on avait presque 11.000 candidats, 4800 ont été sélectionnés, dont 30 seulement retenus, au bout d’un concours écrit et d’un test psychotechnique, pour déceler les capacités de mémoire visuelle qui sont très importantes si l’on veut faire ce métier.
© Maroc Hebdo. Tous les droits sont réservés