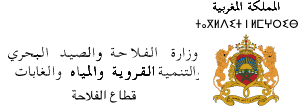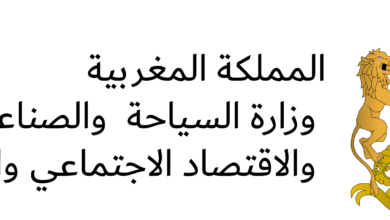Réveil Courrier du 9 mai 2023 – Courrier international
Chaque matin à 6h, le meilleur de la presse étrangère
Asie. “Une série d’attaques ciblées” : en Inde, des violences interethniques font 60 morts
Pendant que vous dormiez. Gaza, Serbie, Canada, Turquie, Twitter : les informations de la nuit
Parade. En Russie, un 9 Mai “très modeste” sur fond de guerre en Ukraine
États-Unis. “On ne possède plus rien” : les militants du droit à la réparation face aux lobbys
Équité. Au Maroc, l’inégalité dans l’héritage, un des derniers tabous des droits des femmes
Portrait. Sahra Wagenknecht, la “Rosa Luxemburg” qui tente de révolutionner la gauche allemande
Reportage. Dans la caverne d’Ali Baba du Parlement européen
Les autorités locales de l’État de Manipur, dans le nord-est de l’Inde, tentaient lundi de stabiliser la région après une flambée de violence meurtrière. Mais les tensions restent vives dans cette zone où la suspicion règne parmi les différents groupes tribaux.
“Un calme précaire règne à Manipur”, rapporte India Today. Selon un bilan dévoilé lundi 8 mai par le gouvernement de cet État du nord-est de l’Inde, “60 personnes sont mortes, 213 ont été blessées et 1700 bâtiments – y compris des sites religieux – ont été brûlés” au cours de la flambée de violence interethnique qui a ravagé la région la semaine précédente, rapporte The Indian Express.
Plus de 20 000 personnes ont fui les troubles qui ont éclaté après qu’une marche de protestation organisée mercredi 3 mai par un groupe tribal a dégénéré en affrontements. Des groupes tribaux sont mécontents de la perspective de voir la communauté meitei, majoritaire dans l’État, reconnue comme “tribu répertoriée”, ce qui permettrait à ses membres d’avoir accès à un quota d’emplois dans la fonction publique et de places dans les universités dans le cadre d’une politique de discrimination positive.
Les Meiteis, majoritairement hindous, vivent à Imphal, la capitale de l’État de Manipur, et dans ses environs, tandis que les Kukis, groupe minoritaire et principalement chrétien, vivent dans les collines. “Quel que soit le parti au pouvoir, le gouvernement de Manipur a toujours été dominé par les habitants des plaines de la communauté meitei, qui représentent environ 53 % de la population de l’État, rappelle le quotidien indien The Economic Times. Par conséquent, ses actions ont souvent été considérées avec suspicion par les tribus – principalement des Nagas et des Kukis – qui représentent 40 % de la population de [l’État de] Manipur.”
Un jeune chef tribal d’Imphal qui a témoigné auprès de CNN sous le couvert de l’anonymat a raconté que sa maison avait été saccagée et vandalisée, le forçant à se réfugier dans un camp militaire. “Je me suis échappé de justesse. La foule était déjà dans la maison. J’ai escaladé la clôture jusqu’à la maison des voisins”, a-t-il expliqué. “Nous avons malheureusement assisté à une série d’attaques très systématiques et bien planifiées, exécutées de façon presque clinique, a-t-il souligné. Ils connaissaient exactement les maisons où résidaient les membres de communautés tribales.”
Lundi, le ministre de l’Intérieur indien, Amit Shah, a affirmé que la situation dans l’État de Manipur était “sous contrôle” et a appelé la population à “maintenir la paix”, rapporte la BBC. Des milliers de soldats ont été déployés, un couvre-feu a été instauré dans plusieurs districts et l’accès à Internet a été suspendu, précise le média britannique. “Les tensions restent vives et la situation instable”, note le site de CNN.
Noémie Taylor-Rosner
Frappes israéliennes à Gaza : douze morts, dont trois chefs du Djihad islamique. L’armée israélienne a annoncé, mardi, avoir mené des opérations ciblées contre trois commandants des brigades Al-Qods, la branche armée de ce mouvement islamiste palestinien qu’Israël considère comme “terroriste”. Des enfants ont également été tués dans ces frappes, selon le ministère de la Santé à Gaza. D’après The Times of Israel, l’État hébreu “s’attend à d’intenses répliques ciblant les villes israéliennes dans les heures à venir”. Les frappes menées par Israël surviennent moins d’une semaine après l’annonce d’une trêve obtenue à la suite d’une médiation égyptienne, après que la mort dans une prison israélienne d’un responsable de ce mouvement, en grève de la faim depuis près de trois mois, avait été suivie d’une nouvelle escalade de la violence entre Tsahal et le Djihad islamique.
Des dizaines de milliers de Serbes protestent contre la violence, après deux fusillades meurtrières. Les manifestants se sont réunis lundi soir devant le Parlement, dans le centre de Belgrade, à l’appel de plusieurs partis d’opposition de gauche et de droite, après deux tueries qui ont ébranlé le pays la semaine dernière, perpétrées par un écolier de 13 ans et un jeune homme de 21 ans. Les protestataires ont réclamé la démission de plusieurs dirigeants, notamment du ministre de l’Intérieur et du chef des services de renseignement, accusés d’inaction, et ont dénoncé la promotion de la violence dans les médias. “En Serbie, le crime est glorifié. Vous pouvez placer n’importe quel type d’images dans la presse, a expliqué dans une interview au magazine Der Spiegel l’expert en sécurité Bojan Elek. L’année dernière, le président Aleksandar Vucic a montré des photos de cadavres sans tête lors d’une conférence de presse, tout en expliquant en détail ce qui était arrivé aux gens, qui les avait assassinés, etc. Il y a un culte du sang. Ce culte est omniprésent en Serbie – et désensibilise les gens.”
L’Ouest canadien demande de l’aide pour lutter contre des feux sans précédent. Des milliers de personnes évacuées, des villages réduits en cendres, des installations pétrolières à l’arrêt : deux jours après avoir déclaré l’état d’urgence, la province canadienne de l’Alberta s’est tournée lundi vers le gouvernement fédéral pour lui demander des renforts. “Le Premier ministre, [Justin] Trudeau, m’a assuré que le Canada serait là pour nous soutenir par tous les moyens possibles”, a déclaré la Première ministre de la province, Danielle Smith. Selon Alberta Wildfire, l’agence de lutte contre les feux de la province, “plus d’une centaine d’incendies brûlent actuellement” à travers l’Alberta, rapporte Radio Canada.
Élections turques : “énorme bagarre” dans un bureau de vote à Amsterdam. La police néerlandaise a annoncé lundi avoir dispersé une foule de quelque “300 personnes” qui se disputaient au sujet du décompte des voix, rapporte le site néerlandais NL Times. Au moins deux personnes ont été blessées. La bagarre a éclaté dimanche soir au centre de conférences RAI Amsterdam, où les électeurs turco-néerlandais pouvaient voter de manière anticipée avant l’élection présidentielle prévue le 14 mai en Turquie. Les médias néerlandais ont diffusé lundi des images montrant de nombreux policiers, dont certains en tenue antiémeute ou accompagnés de chiens, séparant les parties. La dispute, qui a éclaté peu avant la fermeture du bureau, a suivi une altercation entre représentants de formations politiques adverses, selon la radiodiffusion publique néerlandaise, NOS. Les autorités n’ont pas désigné les parties en conflit.
Twitter va supprimer tous les comptes inactifs. Elon Musk a déclaré lundi sur le réseau social que les comptes qui n’ont pas été utilisés depuis plusieurs années seraient retirés, sa dernière annonce en date visant à dynamiser la plateforme. Le site spécialisé TechCrunch note que cette décision devrait permettre de rendre à nouveau disponibles un certain nombre de noms d’utilisateurs convoités. Musk pourrait ainsi “potentiellement attirer d’anciens utilisateurs vers Twitter […] ce qui permettrait finalement de générer des revenus”.
Courrier international
Les célébrations de la victoire soviétique sur l’Allemagne nazie se dérouleront à Moscou “selon le plan”, assure le Kremlin. Les autorités ont en revanche annulé le défilé populaire du “Régiment immortel” sur tout le territoire russe et les défilés militaires dans une vingtaine de villes.
Les célébrations du 9 Mai se dérouleront “selon le plan”, assure le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, utilisant ainsi une formule chère à Vladimir Poutine.
Interrogé sur d’éventuelles restrictions des festivités, notamment du défilé militaire qui se déroule à Moscou, en raison des récentes “attaques de drones” contre le Kremlin, Peskov a visiblement voulu rassurer le public. “Le défilé habituel est en cours de préparation. C’est tout ce que je peux dire. Le président s’exprimera, comme il le fait habituellement”, a-t-il déclaré, cité par l’agence de presse officielle Interfax.
La Russie tient à célébrer la fin de la Seconde Guerre mondiale un jour après le reste de l’Europe, le 9 mai, mettant ainsi en scène “sa” victoire contre l’Allemagne nazie. Au cours des dernières années, cet événement a pris de l’ampleur, devenant une sorte de vitrine de la “nouvelle” Russie, plus forte et respectée sur la scène internationale, voulue par Vladimir Poutine.
“La Russie célèbre le jour de la Victoire de manière massive, somptueuse et fière, avec de nombreux événements patriotiques. L’événement principal de la journée, qui rassemble des dizaines de millions de téléspectateurs devant leur écran, est le défilé de la Victoire”, résume le quotidien Izvestia, proche du pouvoir.
Pourtant, tout porte à croire que, plus d’un an après le début de la guerre en Ukraine, les célébrations de 2023 n’auront pas le
Alexandre Lévy
Anachronique, le dépannage ? La moitié des États américains engagent la bataille contre l’impossibilité de changer soi-même la pièce défaillante d’une moto, d’un tracteur ou d’un smartphone. Ce combat dépasse les questions de propriété intellectuelle et de verrous technologiques, explique “The Christian Science Monitor”.
Cerné d’écrans qui clignotent, Jim Moore pilote à domicile MotherBoards Tech [“La Tech des cartes mères”], son entreprise de dépannage informatique, depuis près de vingt-cinq ans. Au fur et à mesure, les petits ateliers de réparation – autrefois incontournables aux États-Unis – ont quasiment disparu autour de chez lui.
Ce “geek absolu”, comme il se décrit, se demande même si des ateliers indépendants comme le sien ont le droit d’exister à une époque où les logiciels propriétaires sont intégrés dans presque tous les appareils. Jim Moore explique :
La salle de contrôle qui trône dans son salon, dans la banlieue de Savannah [en Géorgie], est au cœur d’une campagne qui prend de l’ampleur dans le pays. Il s’agit de reprendre le pouvoir sur les grandes entreprises et de rétablir le droit fondamental à réparer soi-même – qu’il s’agisse d’un tracteur, d’un téléphone ou d’une Harley-Davidson.
Lancées dans la moitié des États américains, ces initiatives législatives sont indissociables d’un débat qui remonte à la Grèce antique : que signifie la propriété, au fond ? La réponse renvoie à un sentiment très ancré de justice – quand on achète un objet, on part du principe qu’il nous appartient. Mais dans ce pays de bricoleurs où les mécaniciens du dimanche ont longtemps été la norme, la question touche également à l’ingéniosité naturelle des Américains.
Possible que la société change à mesure qu’évolue la nature de la propriété. Mais ces propositions de loi cherchent à préserver une conception traditionnelle de la propriété privée dans un monde de plus en plus numérique.
Il n’y a pas si longtemps, on trouvait toujours un réparateur d’appareils photo en centre-ville. Les dépanneurs d’aspirateurs gagnaient bien leur vie. Les mécaniciens du dimanche bricolaient sans craindre d’invalider la garantie de leur bolide.
Pourtant, près de vingt-cinq ans après l’adoption par le Congrès du Digital Millennium Copyright Act [loi sur le droit d’auteur numérique, en 1998], se pose de plus en plus souvent la question de savoir si on a le droit de dépanner soi-même un objet qui nous appartient. Et si c’est interdit, cet objet nous appartient-il vraiment ?
Cette loi visait à contrecarrer les hackeurs en permettant aux concepteurs de logiciels de protéger une propriété intellectuelle bien méritée. Mais ses détracteurs soulignent qu’elle a également accordé à de grandes entreprises le pouvoir de soutirer des rentes à l’infini.
Certaines imprimantes sont désormais commercialisées avec un paramétrage d’autodestruction qui
Patrik Jonsson
Lire l’article original
En plein chantier de réforme du Code de la famille, le Maroc voit à nouveau ressurgir de nouvelles oppositions concernant le droit à l’égalité dans l’héritage. Une équation des plus complexes, entre évolution sociétale et conservatisme religieux.
Une mesure de précaution pour parer à toute éventualité. “Nous sommes trois sœurs. Notre père a absolument tenu à mettre tout ce qu’il possédait à nos noms pour que nous ne soyons pas lésées au moment d’hériter”, évacue Sanaa*, trentenaire installée à Casablanca. “Il ne voulait pas que ses frères puissent hériter de la grande partie de ses biens.”
Alors que le principe d’égalité entre hommes et femmes est inscrit dans la Constitution de 2011, les inégalités en matière de succession restent l’un des derniers tabous des droits des femmes au Maroc. Un serpent de mer qui ressurgit à intervalles réguliers depuis une dizaine d’années et qui, ces dernières semaines, s’est heurté à la rengaine de la confrontation idéologique entre partisans d’une évolution et franges conservatrices attachées à un système séculaire.
En tête de l’opposition à un projet de réforme, le Parti de la justice et du développement (PJD) [parti islamo-conservateur], au pouvoir lors de la dernière décennie avant d’être largement défait lors des législatives de 2021. Un communiqué diffusé fin février par la formation islamiste a qualifié de “développement périlleux” et de “menace pour la stabilité nationale” les revendications d’égalité, estimant qu’elles pourraient “affaiblir l’un des piliers de la paix sociale et familiale”.
Dix jours plus tard, un groupe de travail hétéroclite composé de figures intellectuelles publiait un document sobrement intitulé “Libertés fondamentales”. Il y est distillé un certain nombre de propositions en faveur des libertés individuelles, dont des amendements au sujet de l’
Mehdi Mahmoud
Lire l’article original
L’une des femmes politiques les plus controversées outre-Rhin, ex-dirigeante de la formation de gauche Die Linke, pourrait créer un nouveau parti en vue des élections européennes. Le journal conservateur “Die Welt” revient sur le parcours d’une femme qui concentre en elle l’histoire de la social-démocratie allemande.
Sahra Wagenknecht a annoncé qu’elle ne se porterait plus candidate pour le parti de gauche radicale Die Linke. Voilà qui constitue un pas de plus vers son retrait politique, et les observateurs se demandent si celui-ci ne pourrait pas se terminer par un nouveau départ : la fondation d’un nouveau parti de gauche.
C’est la fin d’une époque. Sahra Wagenknecht était entrée en 2004 au Parlement européen pour le PDS [Parti du socialisme démocratique, l’héritier du SED, l’ancien parti au pouvoir en Allemagne de l’Est], puis au Bundestag pour Die Linke en 2009, où elle avait dirigé le groupe parlementaire pendant plusieurs années avec Dietmar Bartsch. Cependant, tout indique maintenant qu’elle va prendre congé.
On peut y voir une histoire de malentendus, de désaccords et de petites vacheries. Ou la grande histoire de la gauche allemande, après la fin de la République démocratique d’Allemagne (RDA) et de la social-démocratie.
Sahra Wagenknecht s’est toujours dressée contre l’esprit de son temps, ce qui ne lui a pas valu que des amis, surtout au sein de son parti. C’était déjà le cas à l’époque où le PDS voulait se débarrasser de tout ce qui sentait le passé, la RDA ou Staline.
Tout le monde au parti voulait intégrer le système de l’Allemagne de l’Ouest, Wagenknecht était la seule à trouver des mots de louange pour la défunte RDA, qui était selon elle plus progressiste que la RFA sur les questions sociales et les biens publics. “Si elle continue comme ça, elle va devenir la réincarnation de Rosa Luxemburg”, avait déclaré Lothar Bisky, le président du PDS à l’époque. Et ce n’était pas du tout un compliment.
Comme Rosa Luxemburg, Sahra Wagenknecht pourrait devenir la chef d’un nouveau parti de gauche : les rumeurs de la mise sur pied d’une “liste Wagenknecht” vont bon train depuis qu’elle a fondé, en août 2018, Aufstehen [Debout – un mouvement inspiré de La France insoumise et de Podemos]. Et ce même si ce dernier n’a pas fait long feu.
Elle a toujours démenti que sa coiffure, les cheveux strictement relevés, s’inspirait de celle de Rosa Luxemburg malgré une ressemblance évidente. La célèbre militante communiste était connue pour ses articles et ses discours mais très contestée au sein de son premier parti – le Parti social-démocrate d’avant la Première Guerre mondiale. Elle dénonçait le militarisme allemand, ce qui lui valait d’être haïe dans les milieux conservateurs et bourgeois. Mais la comparaison avec Wagenknecht s’arrête là.
Si on veut comprendre cette dernière, il ne faut pas remonter cent ans en arrière mais aux derniers jours de la RDA. Née en 1969 à Iéna [dans l’est de l’Allemagne], Sahra souhaite étudier la philosophie à l’université Humboldt de Berlin mais voit dans un premier temps sa candidature re
Jakob Hayner
Lire l’article original
Selon les règles que s’est données le Parlement européen, les députés doivent remettre à l’institution les cadeaux qu’ils reçoivent dans l’exercice de leurs fonctions. “Politico” a visité la salle où ces bibelots prennent la poussière.
Un couloir en courbe au cinquième étage et demi, où, tout au bout, on découvre une sombre alcôve qui dissimule une porte sans indication. À l’intérieur se trouve la dernière demeure des cadeaux qui ont été un jour adressés aux membres du Parlement européen.
C’est une chambre secrète remplie de présents diplomatiques, tous soigneusement étiquetés, mais qui languissent sous clé dans les limbes de la bureaucratie – ni acceptés ni refusés.
Ici on trouve de l’opulent mais aussi du bizarre. Dans un placard, voici une montre taïwanaise donnée à un parlementaire polonais. Dans un autre, un pot de moutarde française, une porte saoudienne en miniature, et puis une plaque commémorative du Parlement indonésien.
Bouteilles de vin de prix, jouets pour enfants, écouteurs sans fil, livres, papeterie, figurines : cinq conteneurs poussiéreux débordent de cadeaux offerts un jour aux législateurs européens par des gouvernements et Parlements du monde entier.
Depuis que cette collection a commencé, il y a près de quinze ans, la crypte – qui est essentiellement un placard à balais amélioré – a connu une paix royale. Mais dans ces derniers mois, lorsqu’on a appris que certains pays, comme le Qatar, le Maroc et la Mauritanie, arrosaient les législateurs européens, elle a soudain pris une nouvelle importance.
Baptisée “Qatargate”, ce scandale a provoqué une introspection au Parlement, où désormais on se chamaille pour savoir comment réviser le code de conduite. Et cela concerne aussi la démarche à appliquer quand on se voit offrir un cadeau. En attendant que les législateurs se décident, c’est ici, dans la salle 55A031 du labyrinthique bâtiment Paul-Henri Spaak, que demeurent les cadeaux non retenus.
De l’extérieur, rien n’indique ce que contient la salle. Elle est verrouillée en permanence. Outre les cadeaux refusés, on y trouve d’anciens dossiers de députés européens.
Politico a pu y accéder grâce au député européen Vert allemand Daniel Freund – qui plaide pour des règles plus strictes en
Eddy Wax
Lire l’article original