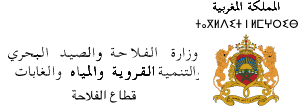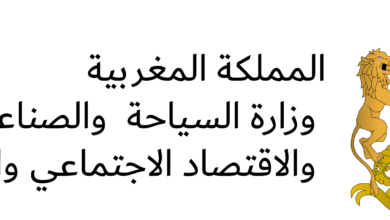Le frère du directeur de la Banque du Liban face à des juges … – Arabnews fr
https://arab.news/pncar
BEYROUTH: Raja Salamé, le frère du gouverneur de la Banque du Liban (BDL), a comparu jeudi devant une équipe de juges européens. Ces derniers enquêtent sur des crimes financiers et le blanchiment d’argent international à hauteur de plus de 330 millions de dollars (1 dollar = 0,91 euro).
La délégation judiciaire, dirigée par la juge française Aude Buresi, a entendu le témoignage de Salamé au palais de justice de Beyrouth dans le cadre d’enquêtes menées par des pays européens sur des transferts financiers en dehors du Liban et sur des transactions effectuées par Forry Associates, dont Salamé est le propriétaire.
Ce dernier avait manqué deux séances la semaine dernière en raison de problèmes de santé, selon un rapport médical soumis à la délégation européenne par son avocat, qui n’a pas assisté à la séance de jeudi, déclarant que son client était «un témoin, non un suspect».
Selon une source judiciaire, la séance a duré six heures et les enquêteurs européens ont posé cent quarante questions, ce qui a conduit Salamé, très agité, à se plaindre de la durée de l’audience.
Selon la loi libanaise, les juges européens ne peuvent pas interroger directement Salamé, mais ils peuvent lui poser des questions par l’intermédiaire d’un juge et d’un médiateur libanais. La délégation ne peut prendre aucune décision d’inculpation ou d’arrestation sur le territoire libanais.
Au moins trois pays, la France, l’Allemagne et le Luxembourg, enquêtent sur Riad Salamé, le gouverneur de la Banque du Liban, et sur son frère Raja. Les deux hommes auraient détourné plus de 330 millions de dollars de la banque entre 2002 et 2015.
La juge Buresi doit interroger Riad Salamé à Paris le 16 mai, mais la comparution du dirigeant de la banque devant la justice française demeure incertaine.
Les enquêteurs européens ont entendu les témoignages de plusieurs personnes parmi lesquelles des dirigeants et des employés de la banque.
Cette semaine, ils ont également interrogé l’assistante du gouverneur, Marianne Hoayek, ainsi que des auditeurs financiers. La délégation doit questionner ce vendredi le ministre des Finances intérimaire, Youssef Khalil; elle quittera le Liban le soir même.
En 2022, la justice libanaise a ouvert une enquête locale sur Salamé après que des enquêteurs européens l’ont interrogé sur son implication présumée dans des affaires de détournement de fonds.
Le ministère public de Beyrouth a accusé les frères Salamé et Hoayek de «détournement de fonds publics, falsification, enrichissement illicite, blanchiment d’argent et évasion fiscale».
L’État libanais, représenté par la juge Helena Iskandar, chef de l’autorité chargée des affaires du ministère de la Justice, a porté plainte contre les trois personnes. Il a demandé leur arrestation, la saisie de leurs biens et de leurs comptes bancaires ainsi que le gel des comptes, au Liban et à l’étranger, qui appartiennent à leurs épouses et à leurs enfants.
Le premier juge d’instruction de Beyrouth, Charbel Bou Samra, a fixé au 18 mai la date de l’audience avec Salamé en tant qu’accusé dans l’affaire locale, indépendamment de l’affaire européenne.
L’enquête locale sera confidentielle.
Une interdiction de voyager a été émise à l’encontre des frères Salamé, mais le gouverneur occupe toujours le poste qui est le sien depuis 1993 et son mandat doit expirer à la fin de ce mois.
Au mois de février, Salamé a répondu aux accusations portées contre lui; il a insisté sur son innocence.
Parallèlement aux enquêtes européennes, le conseil de discipline a décidé à l’unanimité de révoquer la procureure générale du Mont-Liban, la juge Ghada Aoun.
Cette décision se fonde sur les allégations de violations de la loi présentées à l’encontre de Mme Aoun avant l’enquête judiciaire.
Réagissant à cette décision, Mme Aoun a déclaré: «Ils poursuivent le seul juge qui ose enquêter sur de telles affaires. Je n’ai rien inventé et j’ai des preuves; ils me poursuivent parce que je fais mon travail. Je ne crains personne, même s’ils ont l’intention de me tuer.»
Mme Aoun a fait appel de cette décision, mais le Conseil supérieur de la magistrature n’est pas tenu par un délai pour statuer sur cet appel. En attendant, elle se trouve dans l’incapacité de poursuivre son travail. Elle devrait prendre sa retraite dans deux ans et demi.
Mme Aoun avait poursuivi le gouverneur de la BDL ainsi qu’au moins six banques libanaises et une société de transfert d’argent pour blanchiment d’argent et fraude sur la base de revendications d’activistes.
Les banques libanaises sont en grève depuis le mois de février pour protester contre une convocation judiciaire émise par Mme Aoun et contre la levée de l’anonymat des responsables bancaires qu’elle a demandée.
Les banques ont fait valoir que «les actions de Mme Aoun ont porté préjudice à la réputation financière du secteur bancaire libanais à l’étranger, en particulier auprès des banques correspondantes pour des raisons liées à des différends politiques internes».
Ce texte est la traduction d’un article paru sur Arabnews.com
https://arab.news/rxhux
BEYROUTH: Le 13 avril dernier, le film Hardabasht est sorti en salles au Liban. Il s’agit d’un long-métrage tourné à Ouzaï, dans la banlieue Sud de Beyrouth. Il dépeint la vie des personnes défavorisées qui habitent ce quartier transformé en bidonville. Tous les actes sont menés à leur conclusion logique, des disputes routinières entre amis ou officiels aux rébellions légitimes des personnages qui reflètent bien la réalité d’une certaine catégorie de la société.
L’histoire tourne autour d’une mère et de ses trois garçons qui vivent à Ouzaï, dans la banlieue pauvre de Beyrouth. À chaque fils, son histoire, les trois étant impliqués dans des petites «magouilles», le chômage endémique poussant la plupart des jeunes aux trafics en tout genre.
Ouzaï, ville beyrouthine «abîmée»
À l’origine, le quartier d’Ouzaï accueillait d’élégantes stations balnéaires. Petit à petit, occupé par des populations déplacées du sud du Liban, sans cesse soumis aux frappes israéliennes, venues trouver refuge dans la capitale, il s’est transformé en bidonville. Les inégalités de la société libanaise, la pauvreté associée à la violence, ont par la suite généré un stéréotype très négatif des habitants de ce quartier.
L’autre problème majeur auquel ce territoire est confronté: les combats violents qui se produisent de temps en temps entre ses clans. Le moindre problème suscite un conflit meurtrier. Tous les hommes sont armés et ici règne la loi du plus fort.
Connu pour ses trafics illicites, le quartier est placé sous le contrôle des deux grandes formations chiites du pays, le Hezbollah et le mouvement Amal.
13 avril, anniversaire de la guerre civile
Le jour de la sortie du film était celui de la commémoration du jour où le Liban a basculé dans la guerre civile, le 13 avril 1975. L’une des causes de la guerre était une crise d’insécurité croissante.
Miroir du réel
Ce film de quatre-vingt-dix-sept minutes est aussi un hommage aux mères libanaises des quartiers défavorisés, qui vivent dans une inquiétude constante pour leurs enfants et les défendent jusqu’au dernier souffle. «Mensonge. Ce qu’on t’a dit à propos de mon fils Hussein est mensonge. Mon fils Hussein n’a ni tiré ni menacé…» «C’est moi qui ai tiré et qui ai menacé», lance la magnifique Randa Kaadi aux gendarmes venus arrêter ses fils après un meurtre.
Aux côtés de la grande actrice, de tout aussi magnifiques talents soutiennent un récit bouleversant de réalisme: Hussein Kaouk et Hussein Dayekh, les collègues créatifs de Mohammad Abdo, ainsi que Maria Nakouzi, Alexandra Kahwaji, Joseph Zaytoun, Mahdi Dayekh, Husein Hijazi, Randa Kaadi, Fouad Yammine et Gabriel Yammine.
Le film est authentique, car il montre des personnages réalistes qui existent dans la société contemporaine, ce qui lui confère une dimension humaine. Une mise en scène à la fois crue et sensible par Mohammad Dayekh qui décrit son vécu. Hardabasht est plus qu’une simple pulsion de mort.
https://arab.news/nmw6h
TUNIS: Beaucoup de Tunisiens estiment que leur pays dispose de davantage de richesses pétrolières et gazières que celles qui sont officiellement déclarées. Les experts ne leur donnent pas vraiment tort.
Winou el petrol? («Où est le pétrole?») Cette question, un bon nombre de Tunisiens se la posent depuis des années, soupçonnant les autorités de ne pas leur dire la vérité sur les richesses pétrolières et gazières de leur pays. Après plusieurs campagnes sur le sujet depuis 2015, cette question a récemment refait surface.
Réseaux sociaux
Le 6 mars 2023, une ancienne étude américaine datant de 2011 sur le potentiel en hydrocarbures de l’Afrique du Nord a refait surface sur les réseaux sociaux. Elle estime les réserves non découvertes dans le bassin pélagien, qui va des côtes nord de la Tunisie à la Libye, à 3,97 milliards de barils de pétrole, 38,5 billions de gaz naturel et 1,47 milliard de barils de gaz naturel liquéfié.
Interrogé sur le fait de savoir si la Tunisie a un potentiel pétrolier important, Habib Troudi, docteur en géologie et consultant à l’Entreprise tunisienne d’activités pétrolières (Etap), rappelle que l’étude américaine est «une simple étude géologique». Selon lui, des campagnes de prospection sismique menées dans le bassin pélagien tunisien ont permis de découvrir huit champs pétroliers, mais «aucune exploration n’a été menée dans ce bassin depuis 1990 pour la simple et unique raison que la plupart des études ont confirmé l’absence de ressources pétrolières en abondance».
«La Tunisie n’est pas pauvre en hydrocarbures», déclare Khaled Kaddour, ancien ministre de l’Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables.
Pourtant, deux experts à qui Arab News en français a posé la même question sont convaincus du contraire. Ingénieur à la Société italo-tunisienne d’exploitation pétrolière au début de sa carrière, en 1981, PDG de la même société vingt-sept ans plus tard, puis directeur général de l’Énergie au ministère de l’Industrie (2011-2012) et ministre de l’Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables (2017-2018), Khaled Kaddour déclare: «La Tunisie n’est pas pauvre en hydrocarbures, car elle a les mêmes quantités que les pays voisins si on les rapporte à sa superficie».
Mohamed Ghazi ben Jemia est du même avis. Cet expert rappelle que «les réserves actuelles de la Tunisie sont en déclin en raison de l’absence de découvertes importantes durant les vingt dernières années et de la chute du nombre de forages d’exploration». Le spécialiste impute ce phénomène à trois facteurs.
D’abord, la Tunisie «n’a pas les capacités de ses voisins algérien et libyen». Ensuite, ce membre de la Coalition tunisienne pour la transparence dans l’énergie et les mines affirme à Arab News en français que «l’exploration des hydrocarbures n’a jamais été menée correctement; pour cela il faut que nous disposions du cadre juridique et des incitations adéquats». En outre, explique-t-il, certaines régions comme le Centre, le Nord ainsi que la zone off shore «n’ont pas été prospectées de façon intensive jusqu’à présent».
Dernier obstacle
Selon Mohamed Ghazi ben Jemia, le dernier obstacle à une intensification des opérations de prospection est imputable au fait que «les données techniques des zones libres où les investisseurs peuvent déposer une demande de permis sont absentes du site de l’Etap, ce qui ne permet pas à ces derniers de choisir les zones qui peuvent les intéresser; or, ils ne vont pas venir regarder toutes les zones libres de la Tunisie».
Aussi, pour redresser la barre, Mohamed Ghazi ben Jemia recommande d’améliorer le cadre juridique et les conditions de travail des compagnies pétrolières. Il souhaite également que ces données soient accessibles et que «l’Etap et le ministère aillent à la rencontre des investisseurs pour faire la promotion».
https://arab.news/5bhbz
RABAT: L’administration pénitentiaire au Maroc a démenti vendredi “priver du droit de lire et d’écrire” des journalistes et défenseurs des droits humains incarcérés, en réponse à un communiqué de l’ONG Amnesty International.
“A son habitude, Amnesty International a publié un communiqué rempli de calomnies à propos d’un groupe de détenus”, a indiqué la Direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion (DGAPR) dans un communiqué.
Ces prisonniers ont “accès aux livres, revues et journaux apportés par leurs proches, en plus des livres, revues, stylos et papiers mis à leur disposition par les institutions (pénitentiaires)”, assure la DGAPR.
Selon Amnesty, “au moins quatre journalistes et un universitaire sont privés du droit de lire et d’écrire dans les prisons marocaines”, ce qui bafoue “leur droit à la liberté d’expression”.
Parmi les détenus cités, figurent les journalistes Soulaimane Raissouni, Omar Radi et Taoufik Bouachrine, l’ex-bâtonnier Mohamed Ziane, condamnés pour des affaires d’agressions sexuelles, qu’ils nient, ainsi que l’écrivain et militant Rida Benotmane, membre de l’Association marocaine des droits humains (AMDH), emprisonné à la suite de publications critiques sur Facebook.
Dans le dernier classement mondial annuel de la liberté de la presse publié par Reporters sans frontières (RSF), le Maroc a glissé à la 144e place (-9), un rapport dénoncé par le gouvernement marocain.